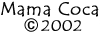Mama
Coca Home
L’économie des cocadollars
:
Production, transformation, exportation des drogues, blanchiment, rapatriement
et recyclage de l’argent criminel en Colombie
Pierre Salama[1]
Les problèmes posés par la production, le commerce et l’usage
des drogues sont pour un économiste à la fois un révélateur
des limites de sa discipline et un stimulant puissant pour leur étude.
L’objet est mal défini, la mesure est pour le moins difficile et
souvent « folklorique »[2],
les comportements des trafiquants sont peu connus, leur changement possible
de statut difficile à évaluer.
L‘objet est mal défini car sa définition dépend
d’un interdit, or ce dernier varie selon les pays et surtout l’époque.
La consommation de feuilles de coca est autorisée dans certains
pays, interdite dans la plupart, le trafic est prohibé mais l’utilisation
de drogues peut ne pas être réprimée dans d’autres
pays. La variété est considérable et les modalités
de celle ci peu connue : la différenciation peut être horizontale
ou bien verticale selon le type de produits et surtout le degré
de pureté, variable selon la répression, l’évolution
des prix. La qualité est donc difficile à apprécier,
la variété n’étant pas définie préalablement
à l’acte de vente par les dealers. La substitution entre
les produits est également peu connue, elle dépend de l’évolution
différentiée des prix, de l’importance de la dépendance,
des modifications du contexte « culturel ». L’essor de produits
de synthèse - de nouveaux cocktails chimiques - est considérable,
leur usage substitue en partie à celui des drogues naturelles, tirée
des plantes transformées à l’aide de produits chimiques,
se mélange parfois à celles-ci, et la distinction entre ce
qui est médicament (donc licite parce que délivré
sur ordonnance), et ce qui ne l’est pas n’est pas toujours aisé,
surtout si ces produits aident à augmenter des performances, telles
que vitesse ou endurance. La professionalisation du sport et sa mercantilisation
à outrance conduisent naturellement au « dopage » des
sportifs. La drogue entre alors comme composante de la reproduction de
la force de travail des sportifs. L’entrée en force de ces produits
est révélatrice de problèmes sociétaux profonds[3],
mais aussi des difficultés rencontrées pour définir
ce qui est drogue et ce qui est médicament[4],
des limites et parfois de l’arbitraire du légal. Vieux problème
puisque déjà rencontré maintes et maintes fois lors
des discussions internationales portant sur la légalisation ou non
de l’opium à la fin du siècle passé et au début
de celui-ci[5],
mais problèmes nouveaux puisqu’il s’agit ici de produits de synthèse,
c’est-à-dire mal définis quant aux effets sur la santé
à moyen et long terme pour ceux qui s’essaient aux multiples cocktails
à la composition plus ou moins mystérieuse.
La mesure est imparfaite principalement parce qu’il s’agit de produits
dont la production, la transformation, la commercialisation sont illicites
et les évaluations, nous le verrons, sont souvent folkloriques.
Elles sont d’autant plus ardues à effectuer que les formes d’organisation
pour la commercialisation, à ses différents stades, s’insèrent
dans un ensemble d’activités informelles qui leur servent de support
et revêtent l’aspect de réseaux mouvants, divers, éloignés
de l’image donnée par la presse lorsqu’elle évoque tel ou
tel cartel. Paradoxalement, on peut obtenir une évaluation, plus
exactement une fourchette macro-économique crédible de la
production des drogues et sa valeur. A l’inverse, l’évaluation des
montants rapatriés directement attribuables à ces activités
criminelles est plus problématique.
Les comportements des trafiquants sont malaisés à cerner
à évaluer. L’ouverture croissante des économies, tant
au niveau des échanges de marchandises que des mouvements de capitaux
facilite les exportations de produits illicites, rend le blanchiment des
capitaux apparemment plus aisé, mais paradoxalement augmente leur
coût, comme nous le verrons. L’entrée en crise profonde de
nombreuses économies ex-socialistes en « transition vers le
capitalisme », ou d’économies dites hier émergentes,
le maintien dans une quasi-autarcie de certaines régions asiatiques
- que ce soit des pays comme la Birmanie ou des régions regroupant
plusieurs pays - à l’exception de ce commerce illicite, tendent
à multiplier l’offre au moment même où la demande dans
certains pays développés parmi les plus importants tend soit
à stagner, soit à régresser, et à se diversifier
vers plus de produits de synthèse et où l’efficacité
de la répression semble augmenter au niveau des saisies. Ces comportement
sont encore plus difficiles à évaluer lorsqu’il s’agit d’estimer
l’ampleur de l’argent rapatrié dans les pays de production. A partir
de quel niveau de la chaîne de commercialisation (gros, semi gros,
détail) doit on considérer que ce comportement cesse? Epineuse
question lorsqu’on connaît les facteurs de multiplication des prix
particulièrement élevés entre le prix à la
production, de gros à l’embarquement, à l’arrivée,
de semi-gros et de détail[6]
(supra). Quelle est la part d’arbitraire lorsqu’on fait l’hypothèse
que les prix à partir desquels on évaluera le rapatriement
possible, sont ceux de gros à l’arrivée pour la cocaïne,
mais ceux de départ pour l’héroïne pour les trafiquants
colombiens? Enfin, au-delà de cette question, qu’est ce qui fonde
ce rapatriement?
Les techniques de blanchiment aussi sophistiquées soient elles
ne peuvent contourner une question essentielle, celle du statut de cet
argent. Qu’est ce qui légitime la possession de comptes importants
d’argent propre? La réponse à cette question est fondamentale
et trace les limites de la recherche de notabilité des trafiquants.
Dans la mesure où il paraît plus simple dans de nombreux pays,
à législation laxiste, de « légitimer l’argent
propre » lorsqu’il est utilisé dans des activités de
construction, de spéculation immobilière ou d’achat de terrain,
on comprend la préférence des trafiquants pour ces activités
et pour ces pays, mais aussi leurs difficultés à se transformer
en « bourgeois industriels ».
L’objet de cet article est d’esquisser les problèmes soulevés
par une évaluation de la production e de la commercialisation des
produits illicites « naturels », puis de présenter les
différentes techniques permettant de rapatrier l’argent sale et
de le blanchir, d’évaluer d’un point de vue macro-économique
l’importance de ces rapatriements et enfin d’analyser les comportements
des entrepreneurs mafieux.
I. Evaluations
de la production et de la consommation dans le monde de la cocaïne
Le moins qu’on puisse dire est que l’évaluation des drogues produites
et consommées s’effectue en information imparfaite. L’observateur
n’a pas de données fiables; le producteur, le trafiquant, le consommateur
ignorent également, à des degrés divers, les données
macro-économique du marché. L’utilisation des probabilités
est difficile, seules des fourchettes de prix, de production, peuvent avoir
un degré de crédibilité satisfaisant; la théorie
des jeux n’a pas été mise à profit, à notre
connaissance[7];
les techniques de l’économie industrielle visant à cerner
des comportements en information imparfaite, comme celles de l’aléa
moral ou de la sélection adverse, aident peu, à ce jour,
tant l’information est imparfaite et la vérification a posteriori
difficile à faire pour réévaluer les comportements.
L’approche probablement la plus crédible consiste à croiser
des informations et des évaluations obtenues en amont (la production
et la transformation) et en aval (la consommation). C’est celle que nous
adopterons car c’est la seule qui rende cohérents les résultats
obtenus du côté de l’offre.
L’analyse en amont consiste à faire une série d’évaluations.
Considérons le cas de la cocaïne, probablement le plus étudié
dans la littérature. On peut estimer la quantité d’hectares
consacrés à la culture de la feuille de coca en sélectionnant
les pays susceptibles de les produire (principalement les pays andins :
Pérou, Bolivie, Colombie, mais aussi Equateur, auxquels il faudrait
probablement ajouter d’autres pays dont l’offre cependant apparaît
jusqu’ici relativement marginale). On estime ensuite les rendements à
l’hectare, différents selon la fertilité des terres, les
engrais utilisés et enfin les modifications climatiques[8].
On obtient une fourchette de quantités produites, à laquelle
il convient de soustraire la consommation locale de feuilles de coca, importante
au Pérou et en Bolivie. Une fois déduite cette consommation,
on obtient une quantité de feuilles dont la transformation en «
pâte» puis en « base » constitue des étapes
relativement simples du processus de transformation. Celle-ci se poursuit
par l’adjonction de divers produits chimiques dans des laboratoires et
aboutit au chlorydrate de cocaïne, c’est à dire à la
cocaïne. Le tableau donne une estimation de la production de feuilles
dans chacun des pays andins producteurs. Pour mieux évaluer l’estimation
de la conversion des feuilles en cocaïne, on a supposé que
celles-ci étaient transformées dans le pays d’origine seulement
à raison de 80% afin de tenir compte de la consommation locale.
Ces facteurs de conversion, différents selon la qualité des
feuilles, sont estimées pour le Pérou à 334 (milliers
de tonnes)/1(tonne), la Bolivie à 373/1, et enfin la Colombie 500/1Tableau
1 : Production de feuilles (en milliers de tonnes) et de cocaïne (en
tonnes)
|
Bolivie
|
Pérou
|
Colombie
|
Total |
|
Feuilles |
Cocaïne |
Feuilles |
Cocaïne |
Feuilles |
Cocaïne |
Cocaïne |
| 1980 |
53 |
70 |
50 |
90 |
2 |
4 |
163 |
| 1981 |
60 |
86 |
50 |
90 |
3 |
4 |
180 |
| 1982 |
60 |
86 |
46 |
80 |
9 |
14 |
180 |
| 1983 |
40 |
43 |
90 |
185 |
14 |
22 |
250 |
| 1984 |
63 |
108 |
97 |
201 |
14 |
22 |
331 |
| 1985 |
53 |
87 |
95 |
196 |
12 |
20 |
303 |
| 1986 |
71 |
124 |
120 |
256 |
19 |
31 |
411 |
| 1987 |
79 |
143 |
191 |
426 |
21 |
33 |
602 |
| 1988 |
78 |
141 |
188 |
418 |
27 |
43 |
603 |
| 1989 |
78 |
140 |
186 |
416 |
34 |
54 |
610 |
| 1990 |
77 |
138 |
197 |
442 |
32 |
51 |
630 |
| 1991 |
78 |
140 |
223 |
504 |
30 |
48 |
692 |
| 1992 |
80 |
145 |
224 |
506 |
30 |
47 |
699 |
| 1993 |
84 |
145 |
156 |
343 |
32 |
51 |
538 |
| 1994 |
90 |
156 |
165 |
366 |
36 |
57 |
580 |
| 1995 |
85 |
146 |
184 |
410 |
41 |
65 |
621 |
source: Steiner op cit p.27. NB: feuilles (production potentielle)
en milliers de tonnes et cocaïne en tonnes.
L’hypothèse simplificatrice d’identité de lieu concernant
la culture des feuilles et leur transformation en cocaïne, nécessaire
pour tenir compte des différents facteurs de conversion, ne correspond
pas à la réalité. La transformation n’est en fait
pas localisée dans les lieux de production. Un pays domine largement
les autres : la Colombie. Les organisations criminelles colombiennes importent
de Bolivie et du Pérou la base qui, ajoutée à celle
produite en Colombie, est transformée en cocaïne et exportée,
à destination principalement des Etats-Unis. La division du travail
entre les pays qui produisent des matières premières sans
les transformer en cocaïne et celui qui opère cette transformation
tend cependant à changer. On considère par exemple que la
participation de la Bolivie s’est accrue ces dernières années
puisqu’elle aurait transformé un peu plus d’un tiers de sa base
en cocaïne en 1990 alors que ce chiffre était seulement de
7% en 1986, en même temps qu’elle accroissait de manière considérable
sa production propre de base[9]
et développait ses exportations vers le Brésil[10].
On considère qu’en 1990, la Bolivie aurait exporté 114 tonnes
de base et 61tonnes de cocaïne, le Pérou respectivement 360
et 40 tonnes et la Colombie approximativement 70% de la cocaïne produite
dans le monde, soit 455 tonnes.
Pour connaître la valeur de la cocaïne exportée, il
faut multiplier la quantité nette[11]
produite par un prix, ou une fourchette de prix. Différents prix
sont à considérer : le prix de gros à l’embarquement,
celui à l’arrivée dans les pays consommateurs, les prix de
semi-gros et de détail. L’hypothèse forte est que la Colombie
contrôle le transport et qu’il faut donc considérer les prix
de gros à l’arrivée pour déduire la quantité
d’argent qui pourrait être rapatriée, une fois blanchie. Hypothèse
forte pour deux raisons : la première est qu’une partie des activités
criminelles dans les pays de destination est le fait également de
réseaux colombiens et qu’en conséquence leur participation
dans la chaîne qui va de la production à la consommation finale
n’est pas limitée à la transformation et au transport, la
seconde est qu’une partie importante du transport s’effectue grâce
à une participation croissante et de plus en plus importante des
réseaux criminels mexicains[12]
parallèlement aux changements de route. Quoiqu’il en soit, cette
hypothèse forte étant admise, le rapatriement possible peut
être calculé année après année, qu’on
croise alors avec les estimations concernant les modalités le rendant
possible (contrebande, sur et sous facturation etc) que nous analyserons
ensuite, en tenant compte à la fois des variations de l’offre et
de celles très élevées et orientée nettement
à la baisse des prix de gros (ceux-ci étant se sont élevés
à un peu plus de 50000 dollars le kilo en moyenne en 1981 à
légèrement au dessus de 10000 dollars en 1994, après
être passés par un creux en 1991[13]
[Rocha (1998) dans Thoumi, p.155].
Les chiffres obtenus, une fois déduites les saisies internationales,
ne sont crédibles qu’à la condition que les estimations faites
sur l’offre soient proches de celles effectuées sur la demande.
La crédibilité de l’évaluation repose donc sur la
confrontation entre les estimations de la production et celles de la consommation.
Reste donc à estimer la consommation. Une manière simple
mais trompeuse de l’évaluer a consisté à multiplier
par dix les quantités saisies, celles-ci étant connues. Cette
approche est cependant peu crédible : la consommation apparaîtrait
comme très élevée et largement supérieure aux
estimations hautes de la production. Une autre façon de procéder
est d’opérer par enquête, en distinguant les consommateurs
occasionnels de ceux qui sont devenus dépendants. Une fois connue
la dépense totale et divisée celle-ci par une fourchette
de prix de détail, on obtient la consommation en volume qu’on peut
alors comparer à celle déduite par des estimations faites
sur l’offre. On obtiendrait ainsi pour les Etats-Unis une estimation de
la consommation de 244 tonnes (estimation basse) à 311 tonnes (estimation
haute) en 1988, soit un chiffre bien plus faible que les estimations reprises
par The Economist en 1989 des travaux d’un sous comité du Sénat
Américain, estimant le trafic mondial des drogues à quelques
500 milliards de dollars, dont 300 pour les seuls Etats-Unis, dont un tiers
pour la cocaïne, soit 100 milliards de dollars, chiffre venant d’une
estimation qualifiée de folklorique par Steiner, faite (op.cit.p.6
et 23), sans qu’on ne connaisse la méthodologie, par la revue Fortune.
Cette évaluation est souvent évoquée dans la presse,
mais aussi par des chercheurs, y compris dans des études sérieuses
mais qui se préoccupent peu des conséquences macro-économiques
d’une telle évaluation [FMI, de Maillard, (1998)[14]],
. Divisée par les prix de gros en vigueur à cette époque,
soit à peu près 40000 dollars le kilo, la consommation aurait
été de 2500 tonnes et divisée par les prix de détail
de plus de 800 tonnes (!). Quoiqu’il en soit, après un pic en 1989,
la consommation décroît pour se situer entre 224 tonnes et
283 tonnes en 1993.Tableau 2: Consommation, saisies et exportations
nettes de cocaïne
|
1988
|
1989
|
1990
|
1991
|
1992
|
1993
|
moyenne
|
| Consommateurs (millions) |
|
|
|
|
|
|
|
| . addictes |
2.54
|
2.62
|
2.47
|
2.22
|
2.34
|
2.13
|
|
| . occasionnels |
7.35
|
6.47
|
5.58
|
5.44
|
4.33
|
4.05
|
|
| Dépenses (milliards de $) |
32.8
|
35.6
|
34.3
|
32.3
|
31.4
|
30
|
|
Prix, estimation haute
($/gramme) |
148
|
138
|
176
|
154
|
154
|
147
|
|
Prix, estimation basse
($/gramme) |
147
|
103
|
165
|
121
|
123
|
117
|
|
| Consommation, en tonnes, avec estimation prix
hauts |
244
|
286
|
215
|
230
|
224
|
224
|
|
| Consommation, en tonnes, avec estimation prix
bas |
311
|
382
|
230
|
293
|
280
|
283
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Consommation aux E-U (en moyenne) |
|
334
|
223
|
262
|
252
|
254
|
265
|
| Consommation mondiale1 |
|
371
|
247
|
291
|
280
|
282
|
294
|
| Saisies mondiales |
|
247
|
247
|
341
|
282
|
266
|
277
|
| Exportations mondiales |
|
618
|
494
|
632
|
562
|
548
|
571
|
| Exportations colombiennes2 |
|
464
|
371
|
474
|
422
|
411
|
428
|
| Saisies d’exportations colombiennes |
|
185
|
185
|
256
|
212
|
200
|
207
|
| Exportations effectives de la Colombie |
|
278
|
185
|
218
|
210
|
211
|
221
|
(1) en supposant que les Etats-Unis représentent 90% du marché
mondial
(2) en supposant que la Colombie fournit 75% du total
source : Steiner (1997), p 24 (pour la production, calculs de l’auteur,
pour la consommation, données fournies par l’ONDCP)
Lorsqu’on tient compte de la consommation d’autres pays et qu’on ajoute
les saisies, on obtient une évaluation des exportations mondiales,
soit 571 tonnes en moyenne de 1988 à 1993 (voir tableau 2). Si on
considère que les exportations colombiennes correspondent à
75% des exportations mondiales, plus fiable que l’estimation légèrement
plus basse de de Rementeria (infra), on obtient le montant des exportations
de ce pays, c’est à dire la production nette des consommations locales.
Si cette évaluation correspond à celle obtenue à partir
de l’analyse de l’offre faite précédemment, on peut penser
qu’elle est globalement pertinente. Ce qui est globalement le cas. La consommation
mondiale moyenne de cocaïne, de 1988 à 1993, se situe aux alentours
de 265 tonnes et les saisies autour de 294 tonnes. Les exportations totales
sont donc de 571 tonnes en moyenne sur la période. La production
estimée, en moyenne sur la même période est de 628
tonnes selon Steiner (voir tableau n°1). L’écart entre les deux
estimations est donc approximativement de 10%, ce qui est faible et certaines
années, il est très faible (par exemple en 1989), mais important
d’autres années (surtout en 1990). Cet écart serait en moyenne
inférieur si on avait pris l’estimation haute de la consommation
et non la moyenne entre les deux estimations. Les deux estimations, production
et consommation apparaissent donc comme crédibles, parce que cohérentes
entre elles.
Deux conclusions peuvent être déduite de ce chiffrage.
La première : la consommation de cocaïne tend à baisser
aux Etats-Unis en même temps que le prix baisse fortement. L’évaluation
du chiffre d’affaire de la cocaïne, que ce soit au niveau des prix
de gros ou de détail, est bien en deçà de celles qu’on
trouve en général dans la presse. La seconde : les saisies
se situent à un niveau très élevé, largement
supérieure aux estimations faites couramment puisqu’elles s’établiraient
à 90% en moyenne de la consommation mondiale, soit un peu moins
de 50% de la production mondiale. Diminuer l’importance des saisies, c’est
rendre incohérent le croisement des données établies
du côté de l’offre et de la demande et soit surestimer la
consommation, soit sous estimer la production, soit enfin les deux. Nous
sommes loin des estimations « folkloriques » annoncées
ici et là et bien souvent par des organismes officiels, dont l’objectif
paraît davantage être la lutte contre la criminalité
que l’exposé scientifique de l’ économie de la drogue.
II. le
rapatriement – blanchiment en Colombie
Les estimations concernant le rapatriement sont difficiles pour deux raisons
: la première concerne les motivations à rapatrier des capitaux,
la seconde le blanchiment proprement dit et les différentes techniques
utilisées. L’analyse que nous allons présenter sera centrée
sur la Colombie, principal producteur mondial de cocaïne, récent
producteur d’héroïne, et lieu d’exportation illégal
de ces produits auxquels il convient d’ajouter la marijuana et les émeraudes.
L’élargissement à l’ensemble des drogues et trafic des émeraudes
s’explique par la difficulté qu’il y a d’attribuer à telle
ou telle activité criminelle l’origine des transferts d’argent «
sales ».
Les motivations du rapatriement sont difficiles à cerner. Pourquoi
une organisation criminelle colombienne aurait intérêt à
rapatrier des capitaux des Etats-Unis en Colombie? Elle pourrait très
bien laisser une partie substantielle de ses gains dans des banques américaines,
ou autres, une fois blanchis. Evoquer le nationalisme des mafieux colombiens
est un argument un peu court, bien qu’il doive probablement jouer, à
l’égal des tueurs liés à ce trafic, fortement imprégnés
par la religion, qui se signent avant de commettre leurs actes et remercient
Dieu du succès de leurs opérations. Un autre argument apparaît
plus pertinent : le blanchiment est davantage qu’un ensemble de techniques
visant à transformer l’argent « sale », c’est à
dire à le faire changer de forme. Il doit également procéder
à un changement de « phase » selon l’expression d’un
financier du cartel de Cali (F.Jurado), reprise par de Maillard (1998,
p.92), c’est à dire donner à l’argent un statut et
le rendre ainsi honorable. Dit autrement, il ne suffit pas de blanchir
de l’argent sale, encore faut il que l’acquisition de capitaux rendus ainsi
« propre » ait une justification plausible. Là réside
en fait la grande difficulté. On peut penser que la proximité
géographique diminue les coûts de transaction et qu’il soit
ainsi plus facile de donner un statut d’argent propre à des capitaux
rapatriés. Ce changement de statut recherché expliquerait
donc en partie le rapatriement. Nous verrons par la suite qu’il ne suffit
pas à donner au mafieux des « titres de noblesse » ,
que la notabilisation de ces derniers est difficile et rend aléatoire
leur transformation en entrepreneurs ordinaires en une génération.
Quoiqu’il en soit la recherche d’un statut honorable à l’argent
blanchi et rapatrié influe sur le choix des techniques utilisées
pour le blanchiment. Comme le blanchiment - rapatriement ne parvient pas
toujours à donner un statut à l’argent, celui-ci suit des
parcours particuliers : il s’investit dans l’immobilier, l’élevage,
la finance spéculative. Outre les facilités offertes par
la géographie - caractérisée par un secteur informel
important, des facilités pour contourner la loi, l’étendue
de la corruption - pour offrir un statut à l’argent blanchi, ces
placements s’apparentent à du recyclage-blanchiment. Dans
ce cas, le blanchiment sert alors au blanchiment.
L’objet de cette section n’est pas d’exposer longuement les multiples
manières de rapatrier et blanchir l’argent sale, cela a été
fait ailleurs et en général fort bien [les rapports du GAFI,
Kopp (sous le dir.de) (1995), de Maillard, (1998), Dupuy, (1998), Thoumi
(sous la dir.de), 1997, Geffray, 1996 et 1998]. Son objet est probablement
moins technique et plus inductif puisqu’il est de montrer que ces techniques
imposent un type de comportement particulier qui, par la suite, rendra
difficile la notabilisation de certains mafieux, limitera leur aire d’investissement
dans des activités de support au blanchiment (hôtellerie,
restauration, salles de jeu...), spéculatives (élevage, construction
immobilière, titres côtés en bourse...) et développera
leur consommation de prestige.
Les techniques utilisées sont nombreuses et évoluent avec
le temps selon l’évolution des réglementations. La particularité
du blanchiment dans ce cas de figure est qu’il inclut la transformation
d’une monnaie en une autre, et ici le dollar, devise forte, contre une
monnaie locale, devise faible. C’est pourquoi il convient de distinguer
ce que nous pourrions appeler le rapatriement-blanchiment du
recyclage-blanchiment.
Les deux mouvements peuvent certes se croiser, se nourrir l’un de l’autre,
mais les problèmes soulevés à l’occasion de chacun
d’entre eux dont différents.
Les techniques les plus simples pour le rapatriement-blanchiment consistent
à envoyer des billets de 100 dollars par voie postale par des résidents
colombiens aux Etats-Unis à leur famille ou à leur faire
exécuter des virements bancaires limités au maximum autorisé
par les législations en vigueur[15],
ou bien à utiliser des « mules » qui transportent des
dollars au retour après avoir « avalé » des sachets
de cocaïne à l’aller. Les sommes transférées
ou transportées de cette manière sont conséquentes
bien que modestes eu égard à l’ampleur des gains, ces techniques,
mais elles restent artisanales[16].
Lorsqu’un contrôle des changes existe, ce qui a été
le cas il n’y a pas encore très longtemps, la technique du
clearing
peut être utilisée. Elle consiste à fournir des devises
à un non résident désirant faire du tourisme aux Etats-Unis,
en échange de la contrepartie dans un pays latino-américain.
Le clearing peut également être utilisé lorsque
le désir d’industriels de placer des capitaux illégalement
en dehors de leur pays rencontre celui d’organisations criminelles de rapatrier
une partie de leurs gains. Dans ce cas, en raison de l’ampleur des sommes
en jeu, un blanchiment préalable aux Etats-Unis est nécessaire.
Ces techniques peuvent être sophistiquées, tout en demeurant
encore artisanales, lorsqu’on tient compte des taux de change, officiel
et parallèle, des taux d’intérêt domestiques et étranger
et de leurs évolutions respectives (c’est pourquoi d’ailleurs on
peut en partie évaluer l’ampleur de ces mouvements par les évolutions
du différentiel de taux [Urrutia et Ponton, 1993]).
Reste trois grandes voies de rapatriement - blanchiment : la contrebande,
les sur et sous facturations des marchandises à l’exportation et
à l’importation et l’utilisation des marchés financiers internationaux.
La sous-facturation des importations est intéressante à
analyser car elle met en jeu plusieurs facteurs : d’un côté,
elle nécessite la mise en place d’un vaste réseau de complicité
pour être effective puisqu’il s’agit de manipuler des prix, donc
des entreprises, afin de blanchir de l’argent sale. D’un autre côté
elle fait intervenir un arbitrage classique entre les différents
taux de change. Donnons un exemple : en période de contrôle
de change, on observe en général la coexistence entre deux
taux de change, l’un officiel et l’autre parallèle. L’ampleur des
fonds transférés, suite aux activités criminelles
étudiées, a conduit à une situation paradoxale en
Colombie : le taux de change parallèle était apprécié
par rapport au taux de change officiel durant de longues périodes.
Les transferts de fonds devenaient alors relativement moins rentables que
la pratique de la sous facturation, puisque pratiquées au taux de
change officiel[17].
A l’inverse la sous-facturation permettait d’acquérir davantage
en monnaies locales par dollar « lavé ». Ajoutons enfin
et, bien que nous ne puissions les présenter dans le cadre de cet
article, que des estimations ont été faites liant les mouvements
du différentiel de taux d’intérêt et la sous-facturation
(Steiner,p.72 et suiv.).
Les sommes transférées par le biais des manipulations
de prix ont été considérables. Leur évaluation,
bien qu’évidemment approximative, est cependant assez fiable. Elle
consiste à comparer les prix déclarés faites par les
sociétés qui exportent en Colombie et les prix annoncés
au niveau des importations, en corrigeant par un coefficient de redressement
tenant compte du prix FOB et du prix CIF et en tenant compte des retards.
Bien que fluctuantes et avec des évaluations parfois différentes
selon les auteurs, les sommes transférées atteignent parfois
des niveaux très élevées (avec un pic de plus de 1,7
milliards de dollars en 1992 en Colombie (CID, p28). Il suffit que les
taux de change et de taux d’intérêt jouent différemment
pour que la sur-facturation remplace la sous-facturation (en 1993, 1994)
comme moyen de blanchir les narcodollars, mais l’ampleur des sommes transférées
par cette voie est plus modeste et les séquences plus rares.Tableau
3 : Sous-facturation (-), sur-facturation (+) des importations en Colombie
selon différents auteurs, en milliards de dollars
|
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
| Rocha, 1993 |
-74,4
|
-84,8
|
254,7
|
53,9
|
-140,7
|
70,6
|
-78
|
59,8
|
-205,5
|
125,5
|
|
|
|
|
| Steiner & Fernandez, 1994 |
-107,9
|
-305
|
205
|
-11,3
|
-183,6
|
3
|
-3,5
|
-117,6
|
-363
|
-8,2
|
-574
|
-1590
|
|
|
| Kalmanovitz, 1992 |
-129
|
-690
|
-1459
|
-1361
|
-1315
|
-1094
|
-1148
|
-1429
|
-1212
|
-1620
|
-969
|
|
|
|
| Mendieta & Rodriguez, 1996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1656
|
491
|
395
|
| CID |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-341
|
-471
|
-1760
|
468
|
478
|
source : CID, op cit , p.28. La méthodologie du CID
est la même que celle de Steiner et Rodriguez
Il peut paraître paradoxal que la contrebande puisse jouer encore
un rôle important au moment où les frontières s’ouvrent
avec la libéralisation des économies depuis une dizaine d’années.
On pourrait certes tenter de l’expliquer par des différentiels de
taux d’imposition indirecte, notamment pour les alcools et cigarettes.
Mais l’argument est insuffisant compte tenu de l’ampleur même de
la contrebande et de la diversification de son offre. La raison essentielle
est que le blanchiment des narcodollars selon ce mécanisme coûte
relativement moins chère. Les conditions d’un fonctionnement efficace
de cette voie sont simples : il faut d’abord qu’il y ait un secteur informel
important, notamment dans des activités commerciales, ensuite qu’existe
une zone libre. C’est le cas de Colon au Panama. Des organisations criminelles
achètent des marchandises dans la zone libre, les paient en espèce
ou en argent « peu blanchi », utilisant parfois des lettres
de crédit (les contrôles étant moins importants, voire
inexistants dans les zones libres). Ces marchandises sont transférées
ensuite en contrebande en Colombie où elles sont vendues dans des
magasins particuliers, qu’on nomme les « San Andrés
» (Gonzalez J.I, dans ce numéro) du nom d’une île colombienne.
Le blanchiment passe donc par une activité de contrebande et par
un commerce illégal qui est loin d’être marginal : les «
San Andrés » constituent un véritable réseau,
constitué parfois de supermarchés, où on trouve des
produits très divers à des prix compétitifs (CID,
1997). Les sommes blanchies sont importantes : environ 1,3 milliards de
dollars en 1993 et en 1994, soit beaucoup plus qu’en 1991 (327 millions)
et 1992 ( 634 millions)[18].
Reste enfin les marchés financiers internationaux. De Maillard
(1998) a montré comment la dérégulation de ces marchés
a permis un essor de la finance criminelle. Les techniques de sur et sous
facturation utilisées à grande échelle, le passage
de compte à compte, utilisant les centres off shore, les
pratiques de secret ou de comptabilités double de certaines banques,
des placements à très court terme dans des produits à
hauts risques, la nécessité de donner un statut à
l’argent reçu, puis enfin le rapatriement sont de plus en plus pratiquées[19].
L’utilisation de l’ensemble de ces techniques est à coût
croissant. On aurait pu penser que la libéralisation financière
et le d’essor des places off shore, le développement des
bourses émergentes, abaisserait le coût de ces transactions.
C’est l’inverse qui se produit. La complexification, la sophistication
des produits financiers, permettent certes de faire transiter des capitaux
de manière particulièrement opaque, et ce faisant de les
blanchir, voire de leur donner un statut, mais l’ensemble des opérations
à un coût élevé Les observateurs s’accordent
pour reconnaître que le coût du blanchiment serait passé
de 5% à 8% au milieu des années quatre-vingts à 15
à 20% à la fin des années quatre-vingt dix (Steiner
p.38 et 39).
III. Une
évaluation macro-économique du rapatriement
1. L’évaluation macro-économique du rapatriement est
difficile pour les raisons que nous avons citées mais aussi parce
que l’argent sale rapatrié et blanchi ne se réduit pas à
celui de la drogue. D’une manière générale, les organisations
internationales considèrent que la moitié de l’argent blanchi
proviendrait du trafic de drogues illicites. Dans certains pays, ce pourcentage
est bien plus faible : le jeu, les armes et surtout la prostitution étant
responsable de la grande majorité des opérations de blanchiment.
Selon les données rassemblées par G.Fabre (1998, p.77 et
suiv.), le trafic d’armes, le proxénétisme, la contrebande
d’hydrocarbures, les jeux clandestins, le trafic de main d’oeuvre et le
narcotrafic rapporteraient 24 à 32 milliards de dollars par an en
Thaïlande, soit un montant équivalent du budget de l’Etat.
Le narcotrafic serait évalué à un milliard de dollars
et constituerait ainsi une activité mineure...Inversement, en Colombie,
il peut sembler naturel de penser que l’argent blanchi provienne essentiellement
de la drogue. C’est le cas, mais ce serait cependant une erreur de penser
que la le narcotrafic constitue la seule composante de ce blanchiment.
La Colombie produit des émeraudes et vend une grande partie de celles-ci
clandestinement (Guillelmet, 1998).[20]Guilllelmet
estime le commerce illicite des gemmes en Colombie à 10% approximativement
de la valeur des exportations - ce chiffre étant probablement moins
élevé dans les années 1993 à 1995 - soit quelque
700 à 800 millions de dollars.
En limitant le blanchiment ici au seul narcotrafic, l’évaluation
des sommes passe par un simple calcul dont les termes cependant sont connus
avec une marge d’erreur plus ou moins importante. Les revenus bruts sont
le résultats des quantités exportés effectivement
- c’est à dire nettes des saisies - par le prix de gros moyen tel
qu’il a été estimé, soit 17600 dollars le kilo en
1990. Il faut soustraire à ce revenu brut - ici 17600$ pour un kilo
- l’ensemble des coûts occasionnés par cette activité.
L’approche de Steiner (op.cit p.38 et suiv.) est intéressante :
elle repose sur une séparation entre les coûts et les revenus.
Elle consiste à soustraire des revenus bruts les coûts de
transformation, de corruption et de transport, et le revenu net ainsi obtenu
servira à payer les paysans, les travailleurs et les exportateurs
colombiens. C’est pourquoi nous allons brièvement la présenter.
Les coûts de transport de la base de la Bolivie et du Pérou,
régions productrices, est de 100$ le kilo et ceux correspondant
au transport de la cocaïne de Colombie aux Etats-Unis seraient de
3000$ le kilo, dont 50% serait payé directement en espèces.
On considère que le coût de transport à destination
de l’Europe serait 30% plus élevé. En pondérant les
destinations par l’importance des marchés, on obtiendrait un coût
moyen de transport de la cocaïne de 3100$ le kilo. La transformation
de base en cocaïne est réalisée grâce à
l’utilisation de produits chimiques dont le coût peut être
estimé à 200$ par kilo de cocaïne produite (certaines
estimations font référence à des sommes plus importantes).
L’argent sale doit être blanchi. Nous avons déjà noté
que le coût de cette opération s’est fortement accru des années
quatre-vingt à aujourd’hui. On l’estime entre 15 et 20% des sommes
à blanchir. Steiner retient le chiffre de 10% jusque 1989 et 20%
des revenus nets ensuite. On peut enfin ajouter à l’ensemble de
ces coûts, 500$ par kilo de cocaïne représentant les
sommes versées pour corrompre, acheter des silences etc.
Comme nous l’avons indiqué, le prix de gros moyen approximatif
du kilo de cocaïne était de 17600$ le kilo. Au détail
ce prix s’élevait en moyenne à 130 000 $ le kilo alors que
le kilo de base (exprimé en équivalent HCL) était
de 500$ au Pérou et 700$ en Bolivie, soit 600$ en moyenne. L’ensemble
des coûts de transport (au sein des Andes et vers les Etats-Unis),
de transformation, de corruption et de blanchiment s’élèvent
à 6800$ par kilo, soit un peu moins de 40% des revenus bruts par
kilo. Les quelques 60% restant serviront à financer le paiement
des paysans, des chimistes et de l’ensemble des mafieux colombiens impliqués
dans le cocatrafic de gros. Les mafias mexicaines, qui font transiter une
part substantielle de la cocaïne (50 à 70% selon les estimations
officielles en 1996), reçoivent selon une part importante de ce
qui est comptabilisé comme frais de transport. Les sommes perçues
à l’occasion de cette opération seront blanchies par ces
organisations criminelles et ne sont donc pas comptabilisées dans
celles qu’ont à blanchir les mafias colombiennes. Pour autant, la
participation croissante des mexicains dans le cocatrafic, et le paiement
d’une part importante directement en espèces, ampute probablement
les revenus nets des colombiens tels que nous les avons calculés
en augmentant la part du coût des transports et en diminuant corrélativement
celle des exportateurs colombiens. L’évaluation des revenus nets
des colombiens est donc probablement surévaluée, d’autant
plus qu’une part croissante de la base et aujourd’hui transformée
en Bolivie et passe par de nouvelles routes, notamment brésiliennes
(Geffray, 1997 et 1998). Quoiqu’il en soit, les estimations des revenus
nets blanchis obtenus avec cette approche aurait été en moyenne
de 1987 à 1995 de 1,638 milliards de dollars avec un minimum de
1,2 en 1994 et un maximum de 2,5 en 1989.
On ajoute à ces revenus nets ceux tirés de la production
exportée de marijuana et de celle récente d’héroïne
(avec l’hypothèse pour cette dernière que ce sont les prix
de gros à l’embarquement qui sont pris en compte), et on obtient
approximativement 2,5 milliards de dollars auxquels il conviendrait d’ajouter
les sommes blanchies tirées du trafic illicite d’émeraudes,
soit 600 à 700 millions de dollars nets de frais de blanchiment.
Les résultats, hors émeraude, de ces estimations peuvent
être présentés dans le tableau suivant :
Tableau 4. Estimation des profits nets du Commerce de la drogue en
Colombie (millions de dollars)
| Estimations Steiner |
Autres estimations |
|
Cocaïne |
héroïne |
Marijuana |
Total |
GMS* total |
Rocha**, min. |
Rocha, max. |
| 1980 |
1386 |
|
|
1386 |
|
1358 |
|
| 1981 |
1933 |
|
137 |
2070 |
2231 |
2617 |
|
| 1982 |
1819 |
|
65 |
1884 |
3835 |
1427 |
|
| 1983 |
1868 |
|
79 |
1947 |
2242 |
754 |
|
| 1984 |
4093 |
|
79 |
4172 |
1425 |
973 |
3843 |
| 1985 |
2933 |
|
20 |
2953 |
1423 |
866 |
3361 |
| 1986 |
939 |
|
34 |
973 |
1367 |
550 |
2443 |
| 1987 |
1311 |
|
152 |
1463 |
881 |
582 |
3707 |
| 1988 |
1395 |
|
290 |
1685 |
718 |
699 |
6699 |
| 1989 |
2485 |
|
94 |
2579 |
1047 |
523 |
6455 |
| 1990 |
2341 |
|
48 |
2389 |
693 |
233 |
4037 |
| 1991 |
1400 |
756 |
83 |
2239 |
337 |
547 |
3539 |
| 1992 |
1822 |
756 |
89 |
2667 |
|
767 |
3409 |
| 1993 |
1363 |
756 |
368 |
2487 |
|
801 |
3232 |
source : Steiner op.cit. p.48; *GSM pour Gomez H et Santa Maria
M (1994) : « La economia subterranéa en Colombia » in
Steiner; **Rocha R (dans Thoumi, op.cit).
Les sommes blanchies sont considérables. Rapportées aux
exportations officielles, elles atteignent des proportions significatives
: 35% en 1992, 34% en 1993, 27% en 1994 et 24% en 1995 pour le blanchiment
du seul narcotrafic. La tendance est certes décroissante, en raison
de l’ouverture de l’économie et à la très forte croissance
des exportations à partir de 1994, mais elle reste à un niveau
très élevé. Il est dés lors évident
que d’un point de vue strictement macro-économique, cet afflux de
dollars, sous les formes diverses empruntées par le blanchiment,
n’est pas sans influence sur l’activité économique d’une
manière générale. On pourrait penser par exemple,
qu’à l’égale de la rente, elle puisse provoquer un «
dutch desease », c’est à dire apprécier le taux de
change, participer à la destruction de pans entiers de l’économie
faute de compétitivité suite à une différenciation
des prix relatifs entre secteurs exposés et protégés.
Cette évolution n’est cependant pas inscrite nécessairement
dans la logique de cette narcoactivité (Salama, 1994). Il est problématique
d’attribuer à la culture, la transformation, l’exportation de drogues
illicites, le qualificatif de rente dans la mesure où, d’un côté
il s’agit d’activités reproductibles à la différence
de l’or noir par exemple, et d’un autre côté, d’activités
privées illégales sur lesquelles, par définition,
l’Etat ne peut collecter l’impôt. Le seul rapprochement qu’on puisse
faire avec la rente est que les revenus provenant de cette activité
illicite ne dépendent pas du travail, mais d’un interdit. Comme
pour une rente minière, l’enrichissement n’est pas le produit d’une
capacité à exploiter de manière efficace la force
de travail, mais de la possibilité de s’inscrire dans le circuit
de la rente. Cela étant les sommes considérables tirées
de cette activité pourraient provoquer une appréciation de
la monnaie nationale. On a pu le constater dans les années quatre-vingt
en Colombie lorsque le taux de change parallèle était apprécié
par rapport au taux de change officiel, à la différence de
ce qu’on observait à la même époque dans la plupart
des économies latino-américaines. A l’inverse, l’évolution
récente des taux de change des pays andins n’est pas orientée
vers une appréciation et, bien au contraire, de nombreux pays ont
du dévaluer avec la contagion de la crise asiatico-russe de 1997-1998.
De nombreux facteurs peuvent en effet contrecarrer les effets possibles
d’un afflux de narco dollars : une balance commerciale fortement déficitaire
suite au désarmement douanier, un déséquilibre de
la balance des comptes courants croissant et conséquent suite aux
paiements du service de la dette et des dividendes, un déficit budgétaire[21].
Ceci étant on peut faire un certain nombre de réserves.
2.
Les chiffres présentés reposent sur des hypothèses
discutables. On suppose d’abord que l’ensemble des revenus nets est rapatrié,
ce qui peut ne pas être le cas et surestime de ce fait le blanchiment-rapatriement,
ensuite que les organisations criminelles colombiennes ne sont pas présentes
dans la filière de distribution aux Etats-Unis, ce qui n’est pas
le cas et sous estime la valeur du blanchiment - rapatriement.
Comparer les sommes blanchies par le narcotrafic à la valeur
des exportations pour s’interroger ensuite sur des effets possible de type
« dutch desease » paraît conduire à des impasses
pour deux raisons : la première est d’ordre statistique, la seconde
se situe au niveau des comportements. Les exportations ne sont pas ajustées,
dit autrement elles portent l’empreinte des techniques utilisées
pour blanchir l’argent. Il en est de même pour les transferts et
d’une manière générale les mouvements de capitaux.
Les comportements sont influencés par les techniques utilisées
pour le recyclage et il est difficile dès lors de concevoir la transformation
d’entreprises mafieuses en entreprises ordinaires. Ce sont ces deux points
que nous allons voir.
Le blanchiment affecte les composantes de la balance des paiements puisqu’il
consiste à utiliser les importations, les exportations, transferts
et mouvements de capitaux. La balance des paiements peut s’écrire
de cette manière :
?R = (X - M + Ynx + Trx) + Ck +eo
où ?R correspond à la variation des réserves,
X aux exportations, M aux importations, Ynx aux revenus nets des services,
Trx aux transferts nets, (l’ensemble étant la balance des comptes
courants), Ck au compte capital et eo aux erreurs et omissions.
Les ajustements a effectuer dans la balance des comptes courants peuvent
être représentés de cette manière:
Acc = Mc -Xc + Trx’ +Ynx’
où Acc correspond aux capitaux cachés dans le compte
courant, Mc et Xc la contrebande du côté des importations
et des exportations, Trx’ et Ynx’ les capitaux déclarés comme
transferts nets et comme revenus nets de service. En suivant la présentation
de Rocha (dans Thoumi, op cit) la contrebande peut se définir ici
comme la somme des sous-facturations (contrebande technique) et de la contrebande
(physique). on a ainsi Mc = -M’ + Km et Xc = X’ - Kx, où Kx et Km
représentent la contrebande physique[22]
et M’ et X’ les sous et sur facturation des importations et exportations
(le signe indiquant la sous ou la sur-facturation).
On peut dès présenter la variation des réserves
de la manière suivante :
?R = (X -Xc) - (M -Mc) + (Ynx -Ynx’) + (Trx -Trx’) + (Ck + Acc) +eo,
qui peut s’écrire :
?R = (X-X’) - (M +Mc) + Ynx + (Trx - Trx’) + (Ck + Acc) +eo
Au total, de 1980 à 1994, les capitaux cachés dans la
balance des comptes courants s’élèveraient à quelques
17 milliards de dollars dont un peu plus de 8 pour l’ensemble de la contrebande,
cette dernière se partageant à peu près à égalité
entre les sous-facturations et la contrebande ouverte dite physique selon
Rocha.
Cette présentation est centrée sur les techniques sophistiquées
mais artisanales que nous avons présentées. Elle insiste
sur les capitaux cachés dans la balance des comptes courants et
omet de présenter les mouvements des narcocapitaux qui ne n’empruntent
pas les sous-facturations, contrebande, service et transferts. Plus précisément,
avec la libéralisation financière, cette voie, bien que coûteuse,
est de plus en plus utilisée et il faudrait décomposer Ck
en deux parties, l’une aux mouvements ordinaires (Ck*), l’autre aux mouvements
excessifs (Ck**). On peut alors écrire l’équation simple
suivante de la balance des paiements :
FF = BC (Yw, TCR, Y) + BK ( i-i*) où BC représente la
balance des comptes courants et BK celle
+ + - +
de capital. Yw est le revenu mondial, TCR le taux de change, Y le revenu
national et i -i* le différetiel des taux d’intérêt
avec l’étranger. Plus le revenu mondial augmente, plus les exportations
croissent et les transferts de l’étranger augmentent, la relation
est également positive avec les variations de change lorsque la
monnaie se déprécie. A l’inverse, l’augmentation du revenu
national entraîne une augmentation des importations. Enfin, le différentiel
de taux d’intérêt en faveur du pays hôte suscite des
entrées de capitaux. cette formalisation extrêmement simple
peut être adaptée aux particularités de l’économie
de la drogue de la manière suivante:
FF’ = BC (Yw, ITCR, Y, i + ? - i* ) + BK (i + ? - i*)
+ + - + +
dans laquelle ? représente la proportion de l’économie
criminelle à rapatrier ses capitaux, soit par la voie des comptes
courants, soit par celle du compte capital, et ITCR le nouveau taux de
change suite à l’afflux de devises. Toutes choses étant égales
par ailleurs et pour un même état des anticipations, la représentation
des équilibres sur les trois marchés des biens, de la monnaie
et de la balance des paiements montre que le taux de change devrait s’apprécier,
l’offre de monnaie augmenter suite à l’entrée de devises
et les prix suivre sauf si une politique de stérilisation de la
monnaie est entreprise dans le but de contrecarrer les effets inflationnistes,
mais avec le danger qu’avec l’augmentation des taux d’intérêt
nécessaire pour capter le surplus monétaire, des entrées
de capitaux croissantes aient lieu. Mais ainsi que nous l’avons déjà
noté, l’ensemble de ces effets secondaires ne peut à l’évidence
être apprécié à l’aide d’hypothèses aussi
restrictives. Pour des raisons diverses, le déséquilibre
interne entre l’investissement et l’épargne, l’excédent ou
le déficit budgétaire peuvent varier et s’opposer voire à
l’inverse accentuer des mouvements sur les prix - niveau général
des prix et différentiel entre secteurs exposés et abrités
- et les changes. Les effets directs de l’afflux de narcodollars
sur le PIB, sa structuration entre activités exposé et abrités,
les prix sont spécifiques à chaque pays selon l’état
de leur balance de paiement, l’insuffisance de l’épargne relativement
à l’investissement des résidents, le déficit ou non
du budget et bien sûr leur niveau de développement industriel
et il convient de les étudier cas par cas, avec cependant pour hypothèses
différentes des modèles de « dutch desease »,
l’absence du plein emploi des facteurs de production, l’existence d’une
économie informelle conséquente, l’appropriation privative
et illégale des profits de cette activité et l’impossibilité
pour le gouvernement de les taxer. L’influence de cette entrée de
devises et sa conversion en monnaie locale, bien que spécifique,
n’est pas négligeable, mais ce serait une erreur de plaquer des
conséquences tirées d’un modèle dont les hypothèses
ne semblent pas convenir aux cas étudiés. C’est pourquoi,
il convient d’étudier les effets indirects de ces entrées
d’argent. Ceux ci peuvent être appréhendés à
partir d’une analyse des comportements de entrepreneurs mafieux.
IV. Les
comportements mafieux peuvent ils muter?
Cette dernière section n’a pas pour prétention de traiter
de l’entièreté de ce problème, mais de tracer quelques
pistes. La question essentielle est de savoir si les organisations mafieuses
peuvent se comporter comme des entreprises ordinaires, ou, à l’inverse,
si elles restent profondément marquées par leurs origines.
On ne peut répondre de manière simple à cette question.
Il convient de prendre en considération plusieurs facteurs : la
place où se situent ces organisations dans la filière, l’organisation
de cette filière sous forme de réseaux ou de cartels, les
techniques de blanchiment - recyclage, le poids du passé enfin,
c’est à dire le facteur temps non pas dans sa dimension à
venir, mais dans celle passée.
Les deux premiers facteurs sont importants. On trouve souvent dans la
littérature des références à la dimension relativement
faible des organisations criminelles et à leur articulation en réseaux.
L’activité productive a une dimension réduite car elle est
peu susceptible d’économies d’échelle tant au niveau de la
culture du pavot ou de la feuille de coca que de leurs transformations.
La dimension des entreprises dépendra de ce fait moins de la recherche
de ces économies d’échelles que de celle visant à
réduire les risques au maximum (Cartier Bresson, 1997). Cette dimension
n’est pas la même de ce fait selon que l’on se situe au niveau de
la production, de la transformation, de la vente au prix de gros, de celle
enfin au prix de détail. On peut considérer que si les organisations
criminelles cherchent à intégrer la production, la transformation
et la vente en gros, elles n’auront ni la même dimension, ni la même
organisation sous forme de réseaux que celles qui, achetant les
produits illicites au prix de gros, les revendent ensuite en suivant une
chaîne d’intermédiaires jusqu’au consommateur final. Ni les
problèmes matériels rencontrés, ni l’information quant
au risque, ni les possibilités enfin de le contourner par la corruption
ne sont identiques. Il reste qu’évidemment ces organisations sont
instables puisque les contrats passés peuvent donner lieu à
tromperie sans qu’une instance neutre puisse arbitrer, que la marchandise
est en partie (substantielle) saisie et que la hiérarchie criminelle
peut être démantelée. (Reuter dans Cartier Bresson,
p.79), mais ces risques sont différents selon la place occupée
dans la filière. L’intégration de l’amont vers l’aval, sans
que les organisations aillent jusqu’au stade de la vente en détail,
milite pour une dimension importante, mais les risques encourus et le peu
de flexibilité d’une grande organisation conduisent à la
fois à limiter celle-ci et à les structurer sous forme de
réseaux. Dans les pays latino-américains, on peut supposer
que les organisations criminelles pratiquent une intégration en
forme de huit : à la base est l’organisation et l’encadrement
des paysans sous contrat qui produisent la matière première,
ensuite, plus réduite, la transformation, laquelle est sous le contrôle
de l’organisation criminelle proprement dite. Celle-ci vend la drogue en
gros, blanchit les devises, puis/et les recycle. Une base large : les paysans,
un sommet large également : les détaillants et entre les
deux un noeud : l’organisation criminelle. ces différentes activités
étant totalement séparées et reliées entre
elles par la présence du responsable de l’organisation mafieuse
et de ses assesseurs (Rocha dans Thoumi, p.163)
Le blanchiment - recyclage est une activité très importante
des organisations criminelles. Elle ne doit pas être confondue avec
celle du blanchiment - rapatriement, bien que parfois elles puissent se
chevaucher, voire se confondre. Le recyclage est en général
facilité par l’existence d’un Etat faible, dont les administrations
et autres appareils d’Etat sont fortement sensibles à la corruption,
et par l’existence d’une
économie informelle conséquente
qui, à la différence du narcotrafic, produit illégalement
des biens et services mais dont la production et la consommation ne sont
pas interdites. L’existence de cette économie informelle, la constitution
de l’Etat marqué par son passé récent (rôle
joué par la violence, l’exclusion, la faible citoyenneté
effective) permettent l’élargissement des marges de l’illégal-légal
(Rivelois, 1999) et autorisent de ce fait l’essor des activités
illicites.
Les dépenses des narcotrafiquants sont peu ou prou génératrices
d’emplois et de création de richesses. L’importance des effets sur
la croissance dépend de multiples facteurs : s’il s’agit de dépenses
somptuaires ou directement spéculatives comme l’achat de terrains,
les effets sur la création de richesse sont faibles, sinon nuls.
S’il s’agit de dépenses dans le secteur de la construction, les
effets d’entraînement en amont peuvent être importants et source
d’activités productives nouvelles grâce à l’élargissement
des marchés en amont. Les effets indirects sur l’emploi et la création
de richesses dépendent donc à la fois de la part investie
dans les dépenses des narcotrafiquants, et du lieu où ces
investissement sont effectués. Les dépenses les plus spéculatives
sont génératrices de peu d’emplois, sauf dans les activités
de construction, celles qui le sont moins peuvent participer à la
création d’emplois selon l’importance de l’investissement, les techniques
utilisées et surtout les effets d’entraînement en amont possibles.
Le recyclage s’effectue prioritairement dans certains secteurs (Castelli,
1999) comme le tourisme (restauration, hôtellerie, casinos) parce
qu’il peut être de nature à permettre des blanchiments futurs,
dans la spéculation immobilière et l’achat de terrains (parce
que la réglementation sur l’origine des fonds est en général
plus laxiste et que le possesseur d’argent blanchi peut le recycler et
trouver ce faisant un statut à cet argent qui lui fasse peu courir
des risques d’enquêtes sur l’origine de ses fonds), dans l’industrie
pharmaceutique (parce que ceci permet l’acquisition sans trop de risques
de produits chimiques nécessaires à la transformation de
la matière première), dans des entreprises situées
dans des secteurs où la possibilité est grande soit, de falsifier
les comptes - permettant les sous et sur-facturations -, d’établir
des doubles comptabilités, soit de s’établir dans des activités
de service (banques, sociétés de bourse).
La panoplie d’entreprises à la marge de l’activité directement
illicite a dès lors deux logiques, l’une de reproduction classique
du capital, l’autre de blanchiment et de recyclage. Ces deux activités
sont complémentaires jusqu’à un certain degré et il
serait erroné de penser que la première puisse se substituer
intégralement à l’autre car elles reposent sur deux manières
opposées de résoudre les conflits : la loi et la violence.
Les deux ne pouvant coexister durablement sans déteindre l’une sur
l’autre, soit l’entreprise quitte son statut mafieux, soit elle le conserve
et la loi est gangrenée dans son application par la violence de
la corruption ou bien celle directement physique.
Le poids du passé n’est pas neutre. Ce serait une erreur de penser
que les comportements soient commandés par la seule optimisation
de choix visant un objectif futur (Dupuy JC, 1997). L’erreur passée
ne peut être traitée comme un « coût irrécupérable
» qu’il conviendrait d’accepter pour optimiser les choix visant un
futur possible. Ils imprègnent les comportements et donc influent
sur les choix effectués, comme s’il s’agissait « d’amortir
» l’erreur faite[23].
Cette observation sur la rationalité vise à expliquer que
lorsque l’enrichissement vient d’une activité de rente illicite
et de sa capacité à s’inscrire dans le circuit de cette rente,
il est très difficile d’abandonner cette manne au profit d’un enrichissement
moins lucratif venant de l’organisation et de l’exploitation de la force
de travail, c’est à dire du profit. De même est il très
difficile de viser le long terme dans le choix de ses investissements[24].
L ’ «erreur » tend à se répéter et l’illégal
à prendre le dessus sur le légal, transformant les entreprises
en entreprises mafieuses et rendant difficile la notabilisation des criminels
à l’intérieur d’une génération.
****
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, une évaluation
du trafic de cocaïne fiable est possible bien que nous soyons en économie
à information pour le moins imparfaite. Les techniques les plus
simples consistent à recouper les estimations de la production et
de la consommation. Cette estimation est possible parce que les Etats-Unis
sont le principal consommateur et la Colombie le principal producteur de
cocaïne. Celle ci serait beaucoup plus difficile à faire si
nous n’étions pas en présence de cette particularité.
La fiabilité de l’estimation reposerait alors en grande partie sur
l’estimation de la production seule. Elle pourrait être recoupée
par les évaluations faites du rapatriement. Les estimations macroéconomiques
reposent certes sur des hypothèses parfois fortes (pourquoi ne tient
on pas compte de la présence des filières colombiennes dans
le commerce du semi-gros et du détail, le rôle croissant des
organisations criminelles mexicaines paraît négligé,
de même l’impact des nouvelles routes argentines et brésiliennes
sur le chiffre d’affaire contrôlé par les organisations criminelles
colombiennes), mais malgré ces difficultés et insuffisances,
cette évaluation macroéconomique est relativement fiable
dans la mesure où elle recoupe celle qu’on parvient à obtenir
à partir de l’estimation des différentes techniques utilisées
pour rapatrier, blanchir l’argent tiré des activités criminelles.
Il est intéressant de souligner combien ces évaluations diffèrent
des estimations faites « à but politique » pour justifier
telle ou telle mesure de représailles, lorsque elles ne sont pas
diffusées pour légitimer et défendre leur budget,
de la part d’organismes chargés de lutter contre ce trafic illicite
...
Bibliographie
citée
Camara M : « L’émergence des drogues en Afrique : quelques
pistes méthodologiques pour identifier les liens licite/illicite
», dans ce numéro.
Cartier Bresson J (1997) : « Etat, marchés, réseaux
et organisations criminelles entrepreneuriales » dans
Criminalité
organisée et ordre dans la société, colloque publié
par les Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Aix en Provence.
Castelli B (1999) : « Impacts urbains du recyclage de
l’argent de la drogue dans la région des andes : une évaluation
critique », dans ce numéro.
C.I.D. (1997) :
Dinamica comercial y lavado de dolares de
los sandrenistos, Informe final, Univesidad nacional de Colombia, Bogota.
de Maillard J. (1996) : « Le crime à venir, vers
une société fractale » revue Le Débat n°
92, Paris; (1998)
Un monde sans loi, la criminalité financière
en images ed Stock, Paris
Dupuis M.C. (1998):
Finance criminelle, comment le crime
organisé blanchit l’argent sale, PUF, Paris
Dupuy JP (1997) : « Temps et rationalité : les
paradoxes du raisonnement rétrograde » dans Dupuy JP et Livet
P (sous la dir. de) :
Les limites de la rationalité, rationalité,
éthique et cognition, Colloque de Cerisy, La découverte,
Paris
Fabre G. (1998) :
Les prospérités du crime
: trafic de stupéfiants, blanchiment et déstabilisation financière
dans l’après guerre froide. miméo, en cours de publication,
Paris
Geffray C (1996 et 1998) :
Trafic international, blanchiment
local et politique et
Effets sociaux, économiques et politiques
de la pénétration du narcotrafic en amazonie Brésilienne
Rapport d’activité n°3 et 4, ORSTOM, Paris
Guillelmet J.M (1998) :
L’économie informelle comme
mode de développement institutionnalisé, une étude
au travers du cas pratique de la filière de l’émeraude colombienne.
Thèse Université de Nice-Sophia Antipolis.
Kopp P (sous la dir.de,1995) :
L’économie du blanchiment,
Association d’économie financière, Paris
Kopp P et Schirray M (sous la dir. de, 1994) :
Géopolitique
et économie politique de la drogue. Futuribles, Paris, voir
plus particulièrement les articles de M.Schirray : «
Les filières-stupéfiants : trois niveaux, cinq logiques.
Les stratégies de survie et le monde des criminalités ».
Machado L.O. (1997) : « Les mouvements d’argent et le
trafic de drogue, une approche régionale » miméo, Paris
Reuter P et alli (1993) :
Comparating Western
European and North American Drug Policies, RAND, Drug Policy Resarch
Center.
Rivelois J (1999) : « Drogue, corruption et métamorphoses
politiques, application à une comparaison Mexique-Brésil
» dans ce numéro, et (1997) :
Prince des paradis : pouvoir,
drogue et corruption depuis le Mexique, miméo, en cours de publication,
Paris
Salama P et Schirray (sous la dir.de, 1992) :
Drogues et
développement PUF, Paris, voir plus particulièrement
les études de G. Fonséca : « Economie de la drogue
: taille, carctéristiques et impact économique », P.Kopp
: « La structuration de l’offre de drogue en réseaux »,
Destremeau B : « Les enjeux du quat au Yémen ».
Salama P (1994) : « Drogues et économie dans les
pays andins, approches méthodologiques », Tiers Monde n°137,
Puf, Paris
Steiner R (1997) :
Los dolares del narcotrafico Cuadernos
Fedesarrollo n°2 Tercer Mundo editores, Bogota
Thoumi F.E. et alli (1997) :
Drogas ilicitas
en Colombia, su impacto economico, politico y social.. PNUD et Direccion
nacional de estuefacientes, ed: Ariel, Bogota. Voir plus particulièrement
: Thoumi F : « Introduccion y panaroma », Uribe Ramirez
S : « Los cultivos ilicitos en Colombia », Rocha Garcia
R : « Aspectos economicos de las drogas ilegales » et Garzon
Saboya E.A. « Aspectos legales y praxis del narcotrafico y
lavado de dinero ».
Urrutia M et Ponton A (1993) : « Entrada de capitales,
diferenciales de interes y narcotrafico » dans Cardenas M et Garay
L.J. (1993) :
Macroeconomia de los flujos de capital en Colombia y America
Latina . ed Tercer Mundo, Fedesarrollo, Fescol. Bogota
Thoumi F.E. (1994) :
Economia politica y narcotrafico
Tercer
Mundo editores, Bogota
[1]
Professeur, Université de Paris XIII, Greitd-Cedi;
salama@seg.univ-paris13.fr
[2]
pour reprendre l’expression utilisée par Steiner (1997).
[3]
marchandisation du sport ou de manière plus générale,
stress lié à la nécessité d’atteindre certaines
performances dans le travail, et à défaut, aux craintes souvent
légitimes de le perdre.
[4]
qu’on songe à la proportion considérable de la population
en France fortement dépendante, de calmants les plus divers et parfois
très puissants.
[5]
G.Fabre, 1998
[6]
Machado L.O., 1997, Steiner, 1997, Thoumi, 1997.
[7]
Voir Camara dans ce numéro.
[8]
Thoumi et
alli, 1997
[9]
Franks, 1991, dans Steiner, 1997, p18
[10]
Geffray, 1997
[11]
il faut en effet déduire de cette production, la consommation locale
de cocaïne qui, dans les grandes villes, tend à croître.
[12]
Rivelois, (1997), Dupuis, (1998)
[13]
il s’agit du prix minimum payé à Miami. Jusqu’à la
fin des années quatre-vingt, on ne considérait que ce prix.
Depuis, on tient compte de la participation faible mais croissante de l’Europe
(10% environ du marché) où les prix sont à peu près
le double de ceux pratiqués à Miami.
[14]
Le PNUCID, quant à lui, évalue le chiffre d’affaire de l’ensemble
des drogues entre 400 et 500 milliards de dollars, chiffre que reprend
également M.C.Dupuis (1998) sans le discuter, pour quelques pages
plus loin, en donner une autre différente, plus proche des estimations
que nous reprenons. La vente au détail de l’héroïne
serait en moyenne de 17 milliards de dollars et celle de cocaïne 30,5
aux Etats-Unis, soit moins de 50 milliards de dollars (p.48). A ce chiffre,
il faudrait certes ajouter la consommation hors des Etats-Unis, pour autant,
nous sommes loin des estimations dites « fokloriques ».
[15]
lorsqu’on compare les sommes envoyées par les résidents colombiens
aux Etats-Unis en Colombie avant 1980 et après, on observe une augmentation
très importante dont l’explication ne saurait être l’amélioration
de leur niveau de vie (pour plus de détail, voir Rocha dans Thoumi,
p.193 et suiv.)
[16]
il faut savoir que sommes attribuables au seul trafic de cocaïne sont
évaluée à apprimativement 6200 tonnes de billets de
5, 10 et 20 dollars. Même converties en billets de 100 et limitées
au seul prix de grois, leur poids demeure considérable (voir Dupuy,
op.cit)
[17]
à l’inverse s‘il y a des difficultés d’exporter des capitaux,
alors la sur-facturation des importations devient interessante.. on peut
aussi pratiquer la sous ou la sur facturation du prix des exportations.
mais cette voie est difficile lorsque les exportations du pays sont principalement
composées de matières premières dont le prix est fixé
internationalement.
[18]
l’évaluation, bien qu’approximative mais fiable, obéit à
un principe simple : il suffit de noter la valeur des réexportation
de la zone libre de Colon vers la Colombie, données par les services
de la zone:, soustraire à ces montants la valeur des importations
venant de la zone libre et de Panama données par les services de
la statistiques colombien (il ne faut surtout pas utiliser les statistiques
du FMI car celles-ci ne prennent pas en compte les données de la
zone libre mais seulement celles de Panama qui entretient un commerce marginal
avec la Colombie). les données obtenues expriment à la fois
un mécanisme de sous-facturation et une contrebande ouverte considérable
qui trouve un débouché naturel dans le réseau des
magasins de « San Andrés ».
[19]
il est évidemment difficile de faire la part des mouvements de capitaux
occasionnés par une activité « normale » de celle
provenant d’activités criminelles. On calcule les mouvements «
excessifs »à partir d’une modélisation avec l’hypothèse
qu’ils seraient peu sensibles aux évolutions des taux d’intérêt
et de change, mais sensibles à la production de produits illicites.
(pour plus de détail, voir Steiner, Urrutia op.cit.). Il est évalué
à 600 millions de dollars en moyenne pour 1985 à 1989, à
1,17 milliard de 1990 à 1992, et à un peu plus de 800 millions
en 1993 et 1994 (Steiner p.68). il est evidemment difficile d’attribuer
au seul narcotrafic la responsabilité de ces mouvements «
excessifs », puisque d’autres activités illégales comme
le trafic d’émeraude existent en Colombie.
[20]
Soixante dix pour cent des émeraudes seraient exportées illégalement.
La différence entre les sorties enregistrées et comptabilisées
du pays et les entrées enregistrées à l’extérieur
est parfois considérable. Faible au Japon, le rapport entre les
entrées et les sorties atteint plus de 80% aux Etats-Unis, 92% en
Suisse, ces trois pays totalisant 80% de la demande extérieure des
gemmes colombiennes.(Guillelmet p.261 et suiv.) Ces pourcentages varient
avec le temps, selon l’évolution du cours des émeraudes,
la législation sur les taxes, les connexions avec le narcotrafic
etc. on estime par exemple qu’à certains moments, la part exportée
légalement croit accompagnée d’une sur-facturation des exportations
pour permettre le blanchiment d’une partie de l’argent de la drogue (op.cit.p.251)
[21]
Rappelons une évidence comptable : l’excédent net de la balance
des comptes courants doit être égal à l’excédent
net de l’épargne privée sur l’investissement des résidents
auquel il convient d’ajouter l’excédent net du budget. Ce surplus
net est équivalent à l’accumulation d’actifs nets sur l’étranger.
[22]
On estime la contrebande physique en utilisant les informations via la
zone libre de Colon, soit une technique statistique dite des effets aléatoires
de Hausman et Taylor. Elle permet d’estimer un modèle de comportement
de telle sorte que les différences entre les valeurs estimées
et celles observées peuvent être attribuées à
la contrebande. Pour plus de détail, voir Rocha op cit p.182 et
suivantes.
[23]
donnons un exemple classique: l’achat d’une résidence secondaire
peut avoir été une erreur. Le mieux serait de la vendre et
passer ses vacances à l’hôtel. pourtant, on observe que les
individus ayant commis cette erreur, passeront leurs vacances dans cette
résidence, comme s’ils désiraient amortir le coût de
cet achat, ce qui apparemment selon les critères classiques de la
rationalité, est complétement irrationnel.
[24]
d’où la préférence pour les obligations à risque
élevé lorsque les activités s’orientent vers la spéculation
à la Bourse.
Favor compartir esta información
y ayudarnos a divulgarla citando a Mama Coca