Mama
Coca Home
COCAINE : CONTES ET MÉCOMPTES
Pierre SALAMA[1]
Paru dans Recherches Internationales
La cocaïne a ceci de particulier qu’elle concentre en son sein
l’économique, le politique, le social et le symbolique. L’économique
parce que les sommes en jeu sont considérables, le politique en
raison de l’attrait exercé par cette manne considérable,
le social grâce aux retombées et au clientélisme que
ces sommes financent, le symbolique enfin par la sublimation de la violence
que ce trafic engendre. Interdite à la production et à la
consommation, les drogues sont objet de richesse et de violence. Richesse
pour les trafiquants et ceux qu’ils corrompent parce qu’interdite et réprimée.
Dépenses somptuaires, distribution d’une partie des revenus comme
manne vis-à-vis de ceux qu’on « oblige » et dont on
recherche aussi la clientèle. Violence entre trafiquants et avec
l’appareil d’Etat qu’elle gangrène, violence lors de la commercialisation
de la cocaïne, violence lors de sa métamorphose en argent «
propre », violence enfin et corruption, toutes deux étant
étroitement liées et complémentaires. Anonie enfin.
Ce papier se limitera à quelques aspects de l économie
de la drogue. Après avoir rappelé dans une première
partie les difficultés liées à l’évaluation
tant de la production que de la commercialisation des drogues et le rapatriement
– blanchiment de l’argent issu de ces activités illicites, nous
centrerons notre analyse sur deux aspects. Le premier concerne les modifications
des conditions de l’offre de cocaïne et d’héroïne, l’influence
de la répression, les changements considérables du rapport
de force entre les organisations criminelles colombiennes et mexicaines
dans l’exploitation des « routes » vers les Etats unis en faveur
de ces dernières. Ce sera l’objet de la seconde partie. Les rentes[2]
microéconomiques, les mannes versées, la corruption participent
de la désagrégation de la société civile :
la violence se développe à mesure que les organisations criminelles
deviennent plus instables et plus fractionnées avec l’essor de la
répression. L’étude de ces problèmes fera l’objet
de la dernière partie.
I. Quelques problèmes posés par l’évaluation
1. Lorsqu’on compare les données officielles
portant sur les bénéfices comparés tirés de
la production –commercialisation de l’héroïne et de la cocaïne
des deux principaux producteurs, à savoir l’Afghanistan et la Colombie,
on est surpris par les écarts importants qui existent : l’héroïne
(plus exactement dans ce cas, l’opium) est peu lucrative à l’ Afghanistan
(moins de 200 millions de dollars[3],
alors qu’ils produisent autour des deux tiers de la production mondiale[4]),
moins lucrative que pour la Colombie qui produit cependant moins de 3%
de la production d’opium[5]
(Conseil économique et social, 2000). Elle est surtout moins lucrative
que la production – commercialisation de la cocaïne par la Colombie
(plus de deux milliards de dollars) pour une position de domination du
marché mondial semblable à celle de l’Afghanistan pour l’opium.
Le facteur de multiplication entre le prix de la matière première
et celui du produit final est plus élevé pour l’héroïne
que pour la cocaïne mais le nombre d’étapes de fabrication
étant plus grand, on en déduit que l’Afghanistan se limite
à produire la matière première (le pavot) et que l’essentiel
des profits se fait ailleurs, alors que la production récente de
pavot de la Colombie, encore marginale (avec celle du Mexique, le chiffre
s’élèverait à 3% de la production mondiale) et rapporte
davantage que la vente de pavot par les trafiquants afghans. La Colombie,
hier spécialisée exclusivement dans la transformation de
la pâte base en cocaïne, produit aujourd’hui massivement la
feuille, la transforme et contrôle donc l’entièreté
du cycle de production.
La difficulté d’évaluer l’apport des activités
illicites liées à la production et au commerce des drogues
dites dures, est l’opacité de l’information quant aux transformations
(lieux, valeur ajoutée, prix aux différents stades) et plus
particulièrement en ce qui concerne l’héroïne. On reste
surpris par la minceur des informations : rien ou quasiment rien sur les
profits réalisés à chaque stade de la transformation
et de la commercialisation dans différents pays le long des routes
empruntées, sinon des renseignement épars, sans lien entre
eux, lors des saisies. Le peu de travaux scientifiques tranche avec la
production académique des pays andins sur la cocaïne.
2. La seconde observation concerne l’information
fournie par les organismes chargés de lutter contre les drogues
illicites. Celle-ci obéit à des considérations extra-scientifiques
: politiques d’abord (quelles relations maintenir avec tel ou tel Gouvernement
? quelles organisations appuyer et comment bénéficier des
revenus de la drogue pour le faire lorsqu’on lutte contre tel ou tel gouvernement
?), bureaucratiques ensuite (la défense du budget d’une administration
censée lutter contre ces activités illicites). Autant pour
la cocaïne on peut évaluer le degré de pertinence des
données du DEA en raison d’une information moins opaque, résultat
des travaux des scientifiques indépendants de ces organisations,
autant pour l’héroïne cela semble difficile. On constate ainsi
souvent une surévaluation systématique et un biais dans les
analyses. Lorsqu’on considère la production nette exportable de
la cocaïne colombienne[6],
principal producteur, on obtient selon les données fournies par
Rocha (2000 et 2001) par exemple 397,6 tonnes/an en moyenne de 1991 à
1995 et 331,1 tonnes/an de 1996 à 1998. sans tenir compte des saisies
colombiennes et de la consommation locale de cocaïne, ces chiffres
seraient de 435 et de 370,5 tonnes/an (voir tableau 1).
Tableau 1: Evaluation de la production et du commerce de la cocaïne
en Colombie
|
Moyenne annuelle
|
1981-1985
|
1986-1990
|
1991-1995
|
1996-1998
|
|
Aire cultivée nette des éradications
(ha)
|
9000
|
32600
|
42000
|
76900
|
|
Production brute de feuilles nette de perte
(tonnes)
|
6800
|
27800
|
57600
|
125000
|
|
Production nette de saisie et de consommation
locale (tonnes)
|
6400
|
27000
|
56800
|
124100
|
|
Pâte base brute (tonnes)
|
12,8
|
54,1
|
113,7
|
248,1
|
|
Pâte base nette de saisies et de consommation
locale (tonnes)
|
5
|
43
|
87,6
|
223,3
|
|
Pâte base importée (tonnes)
|
100,6
|
322,8
|
369,2
|
165,8
|
|
Production brute de cocaïne (tonnes)
|
100,5
|
348,3
|
435
|
370,5
|
|
Saisies colombiennes (tonnes)
|
5,4
|
21,1
|
35,6
|
37,5
|
|
Consommation locale (tonnes)
|
1,5
|
1,7
|
1,8
|
1,9
|
|
Production nette exportable (tonnes)
|
93,6
|
325,5
|
397,6
|
331,1
|
|
Prix de gros (US$/kg)
|
35800
|
12800
|
10800
|
10500
|
|
Prix de gros ajusté avec vente à
l’UE (US$/kg)
|
39305
|
14237
|
12775
|
13300
|
|
Valeur brute (millions d’US$)
|
3142,5
|
4556,9
|
5079
|
4401,8
|
source Rocha
Ces chiffres sont explicitées : hectares mis en culture net de fumigation,
rendements estimés à l’hectare, coefficient de transformation
des feuilles en pâte base et de cette dernière en cocaïne.
Ces chiffres sont recoupés avec d’autres informations : consommation
d’acides nécessaires pour opérer la transformation chimique,
consommations dans les principaux pays, surtout développés,
à laquelle il convient d’ajouter les saisies opérées
dans ces pays, revenus rapatriables ( quantité et prix de gros)
et rapatriés (évaluation des différentes techniques
de rapatriement-blanchiment) et on peut considérer qu’ils sont fiables
à 10 – 20% prés, ce qui est remarquable compte tenu de l’opacité
de l’information et de son caractère imparfait.. Tel n’est pas le
cas des organisations officielles américaines. Les chiffres sont
annoncés, sans qu’on ait d’information sur les techniques d’évaluation,
à l’exception toutefois des hectares cultivés et détruits.
On apprend ainsi que la production annuelle (potentielle) colombienne de
cocaïne serait de 520 tonnes en 1999[7],
et 435 tonnes en 1998 (tableau 2). Comme on peut l’observer, ils diffèrent
nettement des évaluations données par les chercheurs colombiens
: 370,5 tonnes en 1998(production avant saisies colombiennes et à
fortiori américaines) et 435 tonnes pour le DEA.
Tableau 2 : évaluation des autorités américaines
de la production potentielle andine
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
1999
|
2000
|
|
Pérou
|
460
|
435
|
325
|
240
|
175
|
145
|
|
Bolivie
|
240
|
215
|
200
|
150
|
70
|
43
|
|
Colombie
|
230
|
300
|
350
|
435
|
520 (680)
|
580 (695)
|
|
Total
|
930
|
950
|
875
|
825
|
765 (925)
|
768 (883)
|
Source : Subcommittee on Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources,
déposition de Mc Caffrey. Et ODCCP (2001)
Les chiffres donnés par l’ODCCP (2001) sont en partie les mêmes
que ceux du DEA puisque les autorités colombiennes fournissaient
à cette organisation internationales les chiffres donnés
par le DEA, soit 435 tonnes en 1998, 520 en 1999 et 580 en 2000. Cependant,
depuis peu de temps, le Gouvernement Colombien fournit également
des chiffres dont l ‘élaboration résulterait de la mise en
place d’un nouveau système de surveillance. La production potentielle
colombienne s’élèverait à 680 tonnes en 1999 (au lieu
de 520) et à 695 tonnes en 2000 (au lieu de 580). Au total, pour
l’ensemble des économies andines, la production offerte serait de
825 tonnes en 1998, 925 tonnes en 1999 et 883 tonnes en 2000, le léger
fléchissement s’expliquant essentiellement par les chutes prononcées
des offres boliviennes ( 150 tonnes e 1998, 70 tonnes en 1999 et 43 tonnes
en 2000) et péruviennes (240 tonnes en 1998, 175 tonnes en 1999
et 145 tonnes en 2000).
Nous sommes loin des estimations fournies par les scientifiques colombiens.
La fiabilité de ces chiffres dépend de leur mise en correspondance
avec la consommation et l’ensemble des saisies. Les saisies ont été
importantes, bien plus que celles données couramment au début
des années quatre vingt dix (10% de la production offerte) dont
l’élaboration reste encore un mystère. En 1999, l’ensemble
des saisies mondiales, y compris celles opérées dans les
lieux de production et de transport, serait de 350 tonnes dont un peu moins
de 300 dans les Amériques (ODCCP, 2001), soit un peu plus d’un tiers
des 925 tonnes produites selon ces statistiques, et évidemment beaucoup
plus si on reprend les données de Rocha. Il resterait donc 625 tonnes.
Or la consommation mondiales est loin de correspondre à ces chiffres.
Elle a certes augmenté en Europe et dans les économies dites
émergentes, elle décline aux Etats Unis (Graphiques 2 et
3) et selon les données américaines et de l’OCCDP, elle serait
autour de 350 tonnes[8],
un peu plus de 400 (graphique 1), chiffre bien éloigné des
625 tonnes obtenu par simple déduction. Même si les stocks
ont pu augmenter, l’écart est trop important et met en doute la
fiabilité de ces données et renforce à contrario la
scientificité de ceux obtenus par les chercheurs andins. Il y a
donc surévaluation. Celle-ci peut s’expliquer par deux raisons,
non exclusives l’une de l’autre.
Graphique 1: Marché mondial de la cocaïne
moyennes annuelles
 Graphiques
2 et 3: Marché mondial de la cocaïne/des drogues
Graphiques
2 et 3: Marché mondial de la cocaïne/des drogues
moyennes annuelles


On peut expliquer l’origine de cette surévaluation en faisant
appel d’abord aux analyses économiques de la bureaucratie (toute
bureaucratie défend son budget pour se reproduire). Ce budget est
défini par rapport à ses obligations et dans ce cas la lutte
contre les drogues. L’ampleur de ces obligations dépend de l’évaluation
qu’elle fait sur la production, la commercialisation et la distribution
des produits illicites, il est donc logique qu’elle soit conduite à
surestimer celles-ci. Cette approche est cependant insuffisante. On doit
la compléter par la prise en compte d’éléments géostratégiques
définis par les gouvernements dans leurs rapports avec d’autres
gouvernements. Ces évaluations sont donc aussi dépendantes
des rapports recherchés entre Etats, ce qui introduit un biais important
dans les évaluations (celles-ci « légitimant »
une politique répressive, au niveau financier, commercial, militaire
à terme d’un pays dominant, consommateur, vis-à-vis d’un
pays dominé, producteur). C’est ce biais du politique qui permet
de comprendre que les évaluations aient pu être surestimées
dans le cas colombien, et sous estimées – quant au trafic et ses
conséquences sur les relations gouvernement-organisations criminelles,
au Mexique. Il est intéressant de remarquer que le rôle nouveau
et très important, joué par le Mexique dans le trafic de
cocaïne[9],
ait été systématiquement soit sous estimé,
soit relaté lors des dépositions au Sénat sans que
le gouvernement américain ait tiré les conséquences,
alors que telle n’a pas été la politique suivie à
l’encontre de la Colombie. Les analyses se sont ainsi très souvent
limitées à l’étude des mafias de la drogue, ignorant
les relation étroites établies à l’époque de
Salinas de Gotari avec ces mêmes mafias dans le but de récupérer
une part de la rente et la redistribuer pour alimenter le clientélisme
du parti au pouvoir[10].
Oubli surprenant lorsqu’on sait qu’à la différence de la
Colombie, ce mouvement est allé des politiques vers les mafias et
non des mafias vers les politiques comme en Colombie, mais oubli logique
car obéissant à des considérations géostratégiques
différentes de celles appliquées en Colombie.
A la différence des travaux des institutions internationales,
à l’exception parfois des études du PNUCID, les recherches
des scientifiques andins procèdent par recoupements pour tester
la pertinence de leurs résultats. L’estimation de l’offre, moins
les saisies et la consommation locale, est confrontée aux estimations
connues de la demande dans les principaux marchés. L’estimation
de l’argent rapatrié est faite à partir de l’évaluation
des profits engendrés par ce commerce au niveau de sa commercialisation
«
en gros » et de l’évaluation des différents techniques
utilisées pour rapatrier l’argent sale et le blanchir. C’est pourquoi
sont distinguées les profits rapatriables des profits rapatriés
(tableau supra). Les chiffres ne sont pas assénées
sans qu’on en connaisse l’origine, sans qu’on sache si les revenus sont
ceux tirés du commerce de détail ou de gros (ce ne sont pas
les mêmes organisations qui contrôlent chacune des étapes
et les écarts de prix sont considérables entre le prix payé
au paysan et le prix payé par le consommateur final à New
York. A la différence des données effectuées par le
DEA et de nombreuses organisations officielles, leur pertinence vient de
la possibilité de confronter les résultats obtenus avec les
estimations faites de la consommation de ces produits illicites. Si la
consommation déduite de la production moins les saisies est trop
importantes par rapport à celle obtenue à partir des estimation
que la production est très probablement surestimée. C’est
ce qu’on peut déduire des chiffres fournis par les recherches non
académiques.
II. Les coûts économiques
1. L’internalisation des coûts de production et les effets de leur
réduction
Le coût de production, comme dans toute entreprise, dépend
des conditions de production et obéit à des lois semblables.
Le rendement à l’hectare et la qualité de la feuille constituent
des éléments importants. Si la qualité est insuffisante,
si le rendement n’est pas assez élevé, si enfin et surtout
les conditions d’acheminement du produit (ici la pâte base) deviennent
plus aléatoires du fait des politiques d’éradications des
cultures, de la répression ou tout simplement du moindre contrôle
des mafias (ici colombiennes) sur les mafias locales (ici boliviennes ou
péruviennes) et le désir de ces dernières (ici boliviennes)
de ne pas se limiter à la production de pâte de base (peu
lucrative) et de procéder à la transformation et à
la commercialisation (beaucoup plus fructueuses), alors les coûts
de transaction deviennent trop élevés et l’internalisation
des étapes est plus avantageuse. C’est ce qu’on a observé
en Colombie (intégration en amont) et en Bolivie (intégration
en aval) ces dix dernières années.
Graphique 3: Superficies de culture de feuille de coca dans les pays
andins

Source Rocha (2001)
S’agissant d’une rente, on comprend que le revenu soit très peu
corrélé au prix à la production : Il faut 275 kg de
feuilles de coca, payés au paysan bolivien approximativement entre
5,6 dollars le kg en Bolivie et 2,7 dollars le kilo au Pérou, pour
obtenir un kilo de cocaïne base dont la valeur atteint 1850 dollar
le kilo en Bolivie, 880 en Colombie et 546 au Pérou (ONCCP, 2001).
Celle ci est transformée en cocaïne pure dont le prix de gros
aux Etats Unis valait dans les années 97-98 23000 dollars et 43000
dollars en Europe. Le prix de détail de celle-ci passe à
61000 dollars aux Etats Unis et à 92000 dollars en Europe à
la même époque. On sait par ailleurs que la cocaïne n’est
que très rarement vendue pure (Conseil économique et social
des Nations Unies, 2000). Coupée, son prix s’élève
considérablement et l’écart avec le prix à la production
augmente d’autant.
En raison de l’éloignement considérable entre les coûts
de production et le prix de gros aux Etats-Unis et à fiortiori
le prix de détail, on pourrait penser que les prix versés
aux paysans n’auraient aucune influence. Pourtant, la baisse des prix,
tant de gros que de détail ces dix dernières années[11],
va conduire à resserrer encore davantage les coûts à
la production. Les organisations criminelles vont rechercher non seulement
des coûts plus faibles, comme toute entreprise soumise à la
loi du profit, mais aussi, comme tout oligopsone, vont imposer des marges
plus réduites aux producteurs. Le ratio prix de base sur prix de
gros baisse considérablement comme on peut le voir dans le graphique
suivant. Ceci constitue un paradoxe, paradoxe qui peut s’expliquer par
la concurrence acharnée que se font les organisations criminelles,
plus petites qu’auparavant, plus instables et éphémères
(Bagley, 2001, Rocha 2000 : graphique 4) que par le passé et probablement
plus violentes.
Graphique 4: Phases de l'industrie du narcotrafic

Dans un contexte d’illégalité, avec une répression
accrue et une chute des prix, la violence devrait se développer
: elle est en effet à la fois un moyen de s’affirmer dans un «
jeu » protégé par des barrières à l’entrée
et un moyen de survie. La concurrence est plus instable, les barrières
à l’entrés sont moins importantes avec la diminution de la
taille des organisations mais la répression est aussi plus efficace,
cette nouvelle donne devrait donc constituer un terreau favorable à
une violence accrue. Nous verrons que tel n’est pas nécessairement
le cas, tout au moins en Colombie ces dernières années. Cette
violence est complémentaire à la corruption qui, seule ne
peut suffire à mois que la concurrence ne soit stabilisée.
L’autoritarisme croît aux dépends du clientélisme et
le petit producteur, celui dont le pouvoir de négociation est le
plus faible, en pâtit le plus. A ces coûts il convient d’ajouter
ceux provenant des produits utilisés pour transformer la pâte
base en produit final dans les laboratoires et l’ensemble des coûts
de transaction liés à ce qui rend possible cette production-transformation-
commercialisation, c’est à dire, s’agissant d’un produit illégal,
du prix de la corruption des militaires, des policiers, des services administratifs
de l’Etat, de l’achat des hommes politiques et enfin du clientélisme
vis à vis de ceux dont on recherche l’implication et parfois la
légitimité.
La méthode utilisée par Steiner (op.cit p.38 et suiv.)
pour évaluer les coûts est intéressante : elle repose
sur une séparation entre les coûts et les revenus. Elle consiste
à soustraire des revenus bruts les coûts de transformation,
de corruption et de transport, et le revenu net ainsi obtenu servira à
payer les paysans, les travailleurs et les exportateurs colombiens. Les
coûts de transport de la base de la Bolivie et du Pérou, régions
productrices, est de X1$ le kilo et ceux correspondant au transport
de la cocaïne de Colombie aux Etats-Unis seraient de X2$
le kilo, dont une part décroissante serait payé directement
en espèces. Les mafias mexicaines, qui font transiter une part substantielle
de la cocaïne vers les Etats Unis (autour de 50 %), reçoivent
une part importante de ce qui est comptabilisé comme frais de transport
(notons que les mafias mexicaines ne se font plus payer en dollars mais
en cocaïne en prélevant 50% de la quantité qui transite
par leurs mains et qu’ils distribuent ensuite, d’où leur essor dans
les années quatre vingt dix( c’est ce qui explique que le DEA attribue
au Mexique, dans certaines déclarations, 150 à 200 tonnes
de cocaïne de production de cocaïne alors qu’il s’agit de la
« rémunération » des organisations criminelles
mexicaines). On considère que le coût de transport à
destination de l’Europe serait 30% plus élevé. En pondérant
les destinations par l’importance des marchés, on obtiendrait un
coût moyen de transport de la cocaïne. La transformation de
base en cocaïne est réalisée grâce à l’utilisation
de produits chimiques dont le coût peut être estimé
à X3$ par kilo de cocaïne produite (certaines estimations
font référence à des sommes plus importantes). L’argent
sale doit être blanchi. Le coût de cette opération s’est
fortement accru des années quatre-vingt à aujourd’hui. On
l’estime entre 15 et 20% des sommes à blanchir. Steiner retient
le chiffre de 10% jusque 1989 et 20% des revenus nets ensuite. On peut
enfin ajouter à l’ensemble de ces coûts, 500$ par kilo de
cocaïne représentant les sommes versées pour corrompre,
acheter des silences etc.
Avec un prix de gros moyen approximatif du kilo de cocaïne de X4$
le kilo. Au détail ce prix s’élevait en moyenne à
X5$ le kilo alors que le kilo de base (exprimé en équivalent
cocaïne) était de Xb1$ au Pérou etXb2$
en Bolivie, soit Xb$ en moyenne. L’ensemble des coûts
de transport (au sein des Andes et vers les Etats-Unis), de transformation,
de corruption et de blanchiment s’élèvent à un peu
moins de 40% des revenus bruts par kilo. Les quelques 60% restant serviront
à financer le paiement des paysans, des chimistes et de l’ensemble
des mafieux colombiens impliqués dans le cocatrafic de gros.
Graphique 5: Prix grossiste/prix au détail, et prix base/prix
grossiste

Les prix de gros baissent (graphique 6), les revenus rapatriables (en
pourcentage du PIB) également comme on peut l’observer dans le graphique
5 et le tableau 1.
Tableau 1: Estimations de profits rapatriables et rapatriés
par le nacrotrafic en Colombie

source: Rocha (2001)
2. La hausse des coûts liés aux opérations et de
rapatriement – blanchiment et la persistance de moyen archaïques
Bien que souvent confondus, le rapatriement et le blanchiment sont distincts.
Comme son nom l’indique, le rapatriement est l’acte de faire venir de l’argent
sale de l’étranger. Une des difficultés vient de la nécessité
de convertir une devise en monnaie locale. Plusieurs méthodes sont
utilisées dont les principales (surfacturation, contrebande,
transferts d’argent ) mêlent l’archaïsme à la modernité.
C’est cette combinaison surprenante qui est intéressante. On aurait
pu s’attendre que la libéralisation des marchés financiers
aurait permis à la fois de privilégier leur utilisation au
détriment des méthodes archaïques (contrebande, envoi
direct d’argent liquide) et d’abaisser le coût de ce rapatriement.
Or c’est l’inverse qu’on observe : les marchés financiers sont peu
ou moyennement utilisés, le coût a augmenté (Steiner
1997, Thoumi 1997, Rocha 1999, Salama 1998, Kopp 2001).
Le blanchiment est une opération distincte[12].
Il consiste à donner un statut à l’argent sale. Et, il est
exact qu’il est plus facile de donner une légitimité à
de l’argent tiré d’activités criminelles dans des pays où
il existe des emplois informels en grand nombre, où l’application
de la loi laisse beaucoup de place à l’autoritarisme et où
enfin il est possible de contourner ces lois, voire d’en bénéficier
en versant des commissions, des mannes à ceux qu’on oblige ainsi
et dont on attend en retour un service lié à leur fonction,
c’est à dire dans des pays où l’usage de la corruption est
d’un emploi fréquent et non limité exclusivement aux opérations
très importantes. Corrompus, et surtout corrupteurs, n’atteignent
pas nécessairement une taille comparable à celle qu’on peut
observer dans le marché de l’armement, de la construction civile
dans les pays développés. Les petites organisations criminelles
ont accès à ce marché de la corruption. C’est pourquoi
lorsque le problème de la dimension ne se pose pas avec la même
force que dans les pays développés, lorsqu’il devient possible
d’user de la loi à des fins strictement privatives et contraires
à l’esprit de la loi, lorsque le contexte socio-économique
l’autorise, l’archaïsme des moyens utilisés offre au rapatriement
la possibilité de blanchir l’argent sale.
Les flux financiers sont utilisés par des organisations plus
importantes. La hausse du coût du rapatriement -blanchiment s’explique
alors par l’accumulation de risques : les risque encourus sont dans un
rapport plus que proportionnel à l’augmentation des capitaux destinés
au blanchiment (Kopp, 2001). Plus précisément, une relation
forte existe entre le degré de sophistication des opérations
de rapatriement – blanchiment, la dimension et la stabilité de l’organisation
criminelle et le milieu institutionnel dans lequel elle peut œuvrer. Plus
les opérations sont sophistiquées, plus elles nécessitent
à la fois une séparation des tâches plus importantes,
un risque de plus en plus fort en raison de cette séparation des
tâches dans un monde rendu encore plus opaque par la nature illicite
des opérations à effectuer, et donc un coût de transaction
de plus en plus élevé. Ce sont donc des risques liés
à la probabilité d’une répression et des risques découlant
d’une confiance plus difficile à établir lorsqu’on utilise
des moyens sophistiqués (risque de défection). L’accumulation
de ces risques – répression et défection – rend plus coûteuses
les opérations de blanchiment-rapatriement lorsque les moyens utilisés
sont sophistiquées et ce malgré la libéralisation
accrue des marchés financiers. Paradoxalement, celle-ci, en augmentant
les possibilités de défection, rend de ce fait plus coûteuse
ces opérations sophistiquées, alors qu’une analyse un peu
simpliste aurait conduit à une conclusion inverse. La libéralisation
des marchés facilitent ces opérations illicites, mais à
un coût de transaction plus élevé. On comprend alors
pourquoi les techniques « archaïques » puissent persister.
Elles sont préférées aux autres lorsque la taille
des organisations criminelles n’est pas très importantes et que
les problèmes de confiance sont plus facilement résolus avec
l’utilisation de l’argent liquide.
Les sommes transférées de manière illicite, bien
qu’en diminution en pourcentage du PIB en Colombie (tableau 1) restent
considérables. Elles sont cependant modestes si on les compare à
celles dont « bénéficient » des économies
dont l’activité principales est l’exploitation des ressources pétrolières.
Elles sont également modestes, toujours en termes relatifs, à
celles obtenue par un pays comme l’Egypte qui tire une rente conséquente,
bien que fluctuante, du pétrole, du transit par le canal de Suez,
du tourisme et de l’envoi d’argent de ses travailleurs à l’étranger
(Cottenet, 2000). Il semble peu pertinent dès lors de chercher à
appliquer les thèses de la « maladie hollandaise »,
comme nous avons tenté de le faire nous mêmes dans le passé
(Salama, 1994). Certes, dans les années quatre vingt, le cours de
la monnaie colombienne s’est apprécié, et le cours parallèle
était plus élevé que le cours officiel, situation
paradoxale en Amérique latine à cette époque, mais
ce n’était pas le cas des autres économies andines. Aujourd’hui,
les montants rapatriés sont plus faibles (en pourcentage du PIB)
et la monnaie colombienne a subi des dévaluations. Le raisonnement
repose sur les effets pervers produits par une appréciation de la
monnaie : baisse relative du poids du secteur des biens échangeables
dans le PIB, désertification de l’appareil industriel en raison
d’importations rendues plus faciles, diminution relative des possibilités
de générer le progrès technique et donc les rendements
croissants dans la version croissance endogène de l’exposé
du Dutch Desease (Cottenet, 2000). Ce raisonnement soulève plusieurs
difficultés : d’abord quant à l’évolution du taux
de change réel, nous l’avons souligné, ensuite quant à
la nature de cette rente : elle n’est pas assimilable à une rente
pétrolière précisément parce qu’elle a un caractère
illicite et que son appropriation est privative. Certes les sommes rapatriées
s’orientent surtout vers l’achat de terres, d’immeubles (1999, 2001), et
marginalement permettent des prises de participation dans des sociétés
industrielles, mais on peut considérer que les fondements de cette
orientation nouvelle pourraient être aussi la recherche de moyens
de rapatrier plus facilement l’argent illicite et de le blanchir, plutôt
que la conversion des trafiquants, à la recherche de rentes, en
industriels recherchant une plus value selon les règles traditionnelles
du capitalisme. La localisation de l’argent sale, une fois rapatrié
et blanchi, permet alors de comprendre le peu d’effets d’entraînement
sur l’activité économique et ses faibles capacités
à transformer l’appareil industriel en faveur des pôles dynamiques.
Les effets économiques directs ne sont guère positifs, les
effets indirects sont profondément négatifs dans la mesure
où ils déstructurent la cohérence d’une société
par le maintien à un haut niveau de la violence et de la corruption.
III. Les coûts sociaux : la violence
Lorsque nous avons évoqué la taille plus petite des organisations
criminelles, leur concurrence plus exacerbée, et leur durée
de vie plus éphémère, nous avons indiqué que
cette situation
devrait être génératrice d’une
violence plus importante que lorsque ces organisations étaient plus
importantes et plus stables. Cette relation n’est pas étayée.
L’observation des courbes mesurant le taux d’homicide infirme cette relation
en Colombie, elle peut cependant être observée dans de grandes
villes brésiliennes. Elle est surtout trop économiciste et
donc réductrice. L’observation de l’évolution des taux d’homicide
est instructive. Dans la phase dite de cartellisation, le taux d’homicide
dans les grandes villes colombiennes est plus élevé que dans
la phase qui suit (voir graphique 6 ).
Graphique 6: Evolution du taux d’homicide en Colombie de 1990 à
98

Source: Levitt S et Rubio M, 2000
Le taux d’homicide pour 100000 habitants atteint un pic au début
des années 1990. Il est certes beaucoup plus élevé
que dans les autres pays d’Amérique, El Salvador mis à part
(graphique 7). Ce taux est à peu près sept fois plus élevé
qu’aux Etats–Unis, vingt fois fort qu’au Canada ou au Chili. Mais depuis
1991, ce taux a baissé de vingt pour cent et ce déclin est
surtout attribuable aux grandes villes comme Bogota, Cali et Medellin,
réputées pour leur extrême violence (graphique 8) et
comptabilisant à elles trois 38% de l’ensemble des homicides de
Colombie ( Levitt S et Rubio M, 2000, p.8) : le taux d’homicide dans ces
villes passe de 120 pour 100000 en 1991 à un peu moins de 80 en
1997. Tout en restant supérieur à la moyenne colombienne,
cette réduction sensible conduit à une baisse de la part
de ces trois ville dans l’ensemble des homicides puisqu’on passe de 38%
à 30% en 1997 (idem, .8, aussi Gaviria et Velez, 2001). La
baisse du taux d’homicide moyen en Colombie est plus faible que celle observée
dans les trois principales villes parce que dans de très nombreuses
villes moyennes, le taux d’homicide a augmenté (graphique 9).
Graphique 7: Taux d’homicides comparés

Source: Levitt S et Rubio M, 2000
Graphique 8: Evolution des taux d’homicide des principales villes

Source: Levitt S et Rubio M, 2000
Graphique 9

Source: Levitt S et Rubio M, 2000
La distribution de la violence change également : les 20% de
la population dans les municipes les moins violents étaient responsables
de 5% des homicides en 1990, et de presque 10% en 1997. Bien que la distribution
de la violence reste encore très hétérogène,
on assiste donc à un début de convergence, la violence se
manifeste de manière plus homogène qu’auparavant, elle s’étend
à l’ensemble des villes mais elle diminue dans celle qui étaient
le plus affectées, comme Medellin et Bogota.
Ces données montrent qu’il est difficile d’établir une
relation entre la multiplication d’organisations criminelles de tailles
plus modestes que dans la phase précédente et le degré
de violence, indiqué ici par le taux d’homicide. Certes le taux
est extrêmement élevé, notamment à Medellin,
là où les organisations criminelles et le trafic de drogue
semblent être le plus importants, mais l’évolution de ces
organisations ne conduit pas à une augmentation d’homicide. D’autres
facteurs interviennent comme les familles séparées, le sous
emploi, la dimension des villes, le pourcentage des migrants[13]
(Gaviria et Pagés, 1999). Plus les villes sont importantes, plus
ces facteurs paraissent jouer un rôle important comme on peut le
voir dans le tableau suivant :
Tableau 2: Facteurs favorables au crime en Colombie selon la taille
des villes
|
Dimension des villes
|
Familles séparées
|
« oisiveté »
|
Pourcentage Des migrants
|
Communautés avec des problèmes de drogues
|
|
Inf. à 20
|
21,3%
|
30,1%
|
14,2%
|
14,9%
|
|
20-50
|
22
|
33,6
|
8,5
|
8,1
|
|
50-200
|
25,3
|
30,3
|
11,3
|
14,2
|
|
200-500
|
25,1
|
33,7
|
10,6
|
22,8
|
|
Sup 500
|
25,4
|
33,6
|
6,3
|
21,2
|
Source Gaviria et Pagés (op.cit) à partir des données
de 1997
Mais ces calculs sont hasardeux et les marges d’erreur importantes.
Il est plus difficile d’établir des critères sur les criminels
que sur leurs victimes, pour une raison simple : en Colombie, seulement
38% des homicides conduisent à des investigations et 11% à
des procès alors que pour les Etats-Unis ces chiffres sont de 100%
et 65% respectivement (Levitt et Rubio, p.24 op.cit.). On connaît
donc peu les raisons qui conduisent à un acte criminel, les statistiques
présentées représentant un échantillon discutable.
D’autres travaux cherchent à établir des relations de
causalité avec la distribution des revenus et son évolution
d’une part (Gaviria et Velez, 2001) et, d’autre part, le salaire, le chômage
et un facteur d’inertie (le fait d’avoir commis un crime dans le passé
présagerait d’une grande potentialité à commettre
de nouveau un crime ) (Viegas Andrade et De Barros Lisboa, 2000[14]).
La relation entre le degré des inégalités et le taux
d‘homicide est peu fiable : la Colombie est loin d’être le pays le
plus inégal d’Amérique latine et le Brésil, le Chili,
caractérisés par des inégalités bien plus importantes
connaissent des taux d’homicide plus faibles[15].
On pourrait penser que la relation serait plus solide entre la hausse des
inégalités et l’augmentation du taux d’homicide, mais force
est de constater à la fois une hausse des inégalités
dans les années 90 en Colombie et une baisse du taux d’homicide,
à l’exception des villes moyennes. Il est également vrai
que cette pourrait être le résultat d’une hausse due à
l’évolution des inégalités compensée
par une baisse due à d’autres facteurs, mais l’analyse statistique
ne nous permet en l’état actuelle des connaissances sur les motivations
des criminels de le savoir. Nous retrouvons ainsi le même paradoxe
: aggravation des inégalités, diminution du taux d’homicide,
que celui que nous évoquions au début de cette section lorsque
nous mettions en rapport les changements survenus dans la taille des organisations
et la baisse du taux d’homicide.
Ces études pêchent en fait par leur économicisme.
Ne sont pas prises en compte, ou mal prises en compte, les modifications
de l’environnement familial, culturel. On sait que le rejet des valeurs
communément admises peut conduire à légitimer aux
yeux de la personne qui commet des crimes, ses actes délictueux,
on sait aussi que le divorce entre le discours universaliste et le vécu
quotidien[16]
peut constituer un terrain favorable à l’essor de la violence individuelle
si des forces contraires ne s’y opposent pas (poids de la religion, de
ses valeurs et de ses interdits, cohésion de la famille et résistance
de certaines traditions). La drogue, sa production, sa transformation et
son trafic constituent des véhicules puissant de liquéfaction
d’une société. L’enrichissement rapide possible grâce
au trafic de drogue est donc une variable pertinente pour expliquer l’importance
de la criminalité si toutefois on ne la réduit pas à
ses seuls aspects économiques. Dit autrement, le développement
du trafic de drogue produit une fracture sociétale, elle même
génératrice à la fois d’enrichissement et de violence.
Ce n’est donc pas seulement la perspective d’enrichissement qui conduit
à la violence, mais les effets de l’essor des activités de
drogue sur les valeurs de la société. Dans cette mesure,
on peut comprendre que si l’éclatement des organisations criminelles
en organisations de tailles plus réduite, leur concurrence plus
acharnée et leur espérance de vie plus faible, entretiennent
un climat de violence mais ne conduisent pas nécessairement à
son essor. Les modifications de l’environnement sociétal[17]
à l’inverse peuvent réduire le taux d’homicide.
Contes et mécomptes du trafic de drogues, contes parce qu’on
écrit tout et n’importe quoi sur ce trafic et que la réalité
est souvent en deçà des phantasmes véhiculés
par les médias et les institutions officielles chargées de
lutter contre les organisations criminelles, réalité pourtant
insoutenable qui n’a nul besoin d’être travestie pour apparaître
pour ce qu’elle est, si ce n’est pour légitimer des politiques de
domination et défendre le budget de ces institutions ; mécomptes
car les effets économiques sont loin d’être positifs. Mécomptes
aussi parce que les conséquences sociales et politiques de ce trafic
se traduisent par un délitement de la société civile
avec l’essor de la corruption, le maintien à un niveau très
élevé de la violence.
Annexe
Rapatriement de profits et criminalité


Source Rocha (2000)
Bibliographie
Bagley B.M. (2001) : « Drug Trafficking, Political Violence
and US Policy in Colombia in the 1990s » doc internet :
www.mamacoca.org
Broyer Philippe (2000)
: L'argent sale dans les réseaux
du blanchiment. L'Harmattan, Paris
Camacho Guizado A., Lopez Restrepo A, Thoumi F (1999) :
Las
drogas : una guerra fallida, visiones criticas ed Tercer Mundo-IEPRI,
Bogota
Cartier Bresson J, Josselin C, Manacorda S. (2001) : Définir,
mesurer et évaluer les délinquances économiques et
financières transnationales, rapport pour l’IHESI, étude
et recherche, IHESI Paris
Conseil économique et social – Nations unies (2000)
: Rapport du Secrétariat : Situation mondiale en ce qui concerne
le trafic de drogues, Vienne
Castelli B. (1999) : « Les impacts urbains du recyclage
de l’argent de la drogue dans la région des Andes » Tiers
Monde n°158 ; (2001) : « Les trois mutations structurelles du
blanchiement contemporain : une perspective analytique » miméo,
document pour le colloque internationale de Guadalajara.
Cottenet H (2000) « Ressources exogènes et croissance
industrielle : le cas de l’Egypte » Revue tiers monde n°163 :
Formes et mutation des économies rentières au Moyen orient,
sous la direction de Destremau B.
Departamento nacional de planeacion (2000) : El problema
de las drogas en Colombia (version preliminar) . Santa Fé de
Bogota
De Souza Minayo et
alli (1999): Fala galera, juventude
e cidadania na cidade de rio de janeiro, ed garamond, Rio de Janeiro
D.I.A.L. (2001) : « Une autre façon d’envisager
le problème de la cocaïne » D 2494 Lyon
www.globenet.org/dial
Gaviria A et Pages C (1999) : « Patterns of Crime Victimization
in Latin America », IADB , working paper n°408, Washington (www.iadb.org);
Gaviria
A et Velez C.E. (2001) : « Who Bears the Burden of Crime
in Colombia, Fedesarrollo, working paper, Santa fé de Bogota.
Geffray Christian (2000) : « Etat, richesse et criminels
» Monde en développement n°110, Paris-Bruxelles
IPES –IADB
(2000) : Economic and Social Progress in Latin
America, Development beyond Economics. Wahington
Kopp P (2001) :
Analyse de l’action menée par les
institutions internationalesspécialisées dans la prévention
et la répression des DEFT, rapport pour l’IHESI, étude
et recherche, IHESI Paris
Levitt St. et Rubio M (2000) : « Understanding Crime in
Colombia andWhat can be done about it » . Fedesarrollo, working paper
n°20, Santa fé de Bogota.
ODCCP –UN (2000)
Global ILLICIT Drugs Trends, Vienne
ODCCP –UN (2001)
Tendances mondiales des drogues illicites,
Vienne
Peralva A ; (2001) : « Perspectives sur la violence brésilienne
» article à paraître dans la revue Tiers Monde, PUF,
Paris
Resa Nestares Carlos (2001) : « El estado como maximizador
de rentas del crimen organizado : El caso del trafico de drogas en Mexico
» Biblioteca de ideas , Instituto internacional de gobernabilidad
(www.iigov.org)
Rivelois J. (1999) :
Drogue et Pouvoirs : du Mexique aux
paradis, Editions L'Harmattan, Paris
Rocha Garcia R (1999)
La economia colombiana y la produccion
de drogas illicitas : traz 25 anos de insercion. Document écris
pour l’UNDCP et publié aux éditions Siglo del Hombre Editores,
UNDCP, , Santa Fé de Bogota.
Rocha Garcia R (2001) « Narcotrafico y la economia de
Colombia : una mirada de las politicas », miméo, colloque
de Guadalajara.
Subcommitee on Criminal Justice, Drug Policy and Human Resources
(2000) :Statement by General McCaffrey (www.house.gov/reform/cj/hearings)
Salama, P. (1994): «Drogues et économie dans les
pays andins, approches méthodologiques», revue Tiers Monde
Nº 137, PUF, París ; (1998) : « L’économie
des cocadollars :Production, transformation, exportation des drogues, blanchiment,
rapatriement et recyclage de l’argent criminel en Colombie » revue
Tiers Monde n°158
Steiner, R. (1997):
Los dólares del narcotráfico,
en Cuadernos Fedesarrollo Nº 2, Tercer Mundo editores, Bogotá.
Thoumi, F. E., y otros (1997):
Drogas ilícitas en
Colombia, su impacto económico, político y social, PNUD
y Dirección Nacional de Estupefacientes, Ariel, Bogotá. Veánse
especialmente: F. Thoumi: «Introduccion y panorama», S. Uribe
Ramírez: «Los cultivos ilícitos en Colombia»;
R. Rocha García: «Aspectos económicos de las drogas
ilegales»; y E. A.Garzón Saboya: «Aspectos legales y
praxis del narcotráfico y lavado de dinero».
Tobar Federico (2001) « Economia del delito y la violencia
en Argentina », Biblioteca de ideas , Instituto internacional
de gobernabilidad (www.iigov.org)
US Department of Justice – DEA briefing books (1999) : Major
Drug traffickers (www.usdoj.gov/dea/briefingbook)
Viegas Andrade M et de Barros Lisboa M (2000) : « Desesperança
de vida : homicidio em Minas gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo no periodo
1981/97 » dans Henriques R (sous a dir. de) : Desigualidade e
pobreza no Brasil . IPEA, Rio de Janeiro.
[1]
Professeur, CEPN-Cnrs et Greitd ; ce texte a été écrit
pour le colloque international de Guadalajara :criminalisation de pouvoirs
et trafic de drogue, organisé par l’Université de Guadalajara
et le Greitd-cluny.
[2]
Nous utilisons ici le terme de rente dans son acceptation la plus simple
: il s’agit de revenus liés à l’exploitation de ressources
naturelles, ici les drogues. Ces revenus ne dépendent donc pas des
conditions d’exploitation de la force de travail mais de la disponibilité
de ces ressources. C’est pourquoi on utilise souvent cette expression pour
désigner les revenus tirés de l’exploitation des matières
premières mais aussi, d’une manière générale,
des produits de la terre. Dans le cas particulier des produits illicites,
les revenus dépendent de la disponibilité de ces ressources
naturelles certes mais du degré de répression. Ils sont donc
très peu corrélés au coût de production. Dans
notre article, il s’agira donc des revenus tirés de ces activités
illicites. La manne revêt un sens différent, ainsi que le
soulignait Ch. Geffray (2000) : il s’agit d’une redistribution d’une partie
de cette rente afin d’obtenir des faveurs de la part des gens qu’on oblige
de cette manière . Ch. Geffray donne l’exemple de nombreuses opérations
non rentables selon les critères des économistes, mais qui
survivent : leur fonction n’est pas de produire de la plus value, mais
de blanchir de l’argent sale, d’obliger des personnes qui bénéficient
de cette manne (clientélisme) sans qu’elles puissent manifester
une réciprocité parce qu’elle engendre une « une dette
moralement insolvable » (p.19), de corrompre enfin (« ils achètent
au fonctionnaire un service précis : son renoncement à exercer
sa charge contre eux, tout en continuant de l’occuper puisqu’il
ne leur servirait à rien qu’il démissionne » p.20.Il
s’agit certes d’argent illicites, plus exactement de l’usage d’argent illicite,
mais la manne se distingue de la rente par les services qu’elle oblige
de fournir qui rendent l’ensemble du trafic possible.
[3]
L’Afganistan était responsable en 1999 de 79% de la production mondiale
d’opium, 69% en 2000 – année de forte sécheresse et de l’interdit
de poursuivre les cultures de pavot (dans le but en partie d’écouler
les stocks excédentaires selon Labrousse (Le Monde 22.10.2001).
La production a chuté de 28% en 2000. Les prix ont baissé
(au lieu de s ‘élever avec la réduction de l’offre) compte
tenu de la surproduction de 1999 et on considère que la valeur de
la production – calculée au prix versé au producteur, base
de référence de la taxe versée au gouvernement des
talibans – aurait été de 90 millions de dollars contre 180
pour 1999 (Conseil économique et social-ONU, 2000 et ODCCP-UN, 2001)
Avec la guerre, on peut supposer que l’interdit aura été
levé, de « jure » ou de « facto ».
[4]
Le pouvoir des taliban, en Afghanistan, a cherché à établir
une taxe sur la production d’opium –d’environ 10% -et c’est le produit
de cette taxe qui explique le montant peu élevé relativement
à l’importance de la production. Les trafiquants ont peu rapatriés
les bénéfices tirés de cette activité et les
transformation successives de l’opium, fort lucratives, sont réalisés
dans d’autres pays. Le produit de la taxe que percevait le gouvernement
des talibans peut être considéré comme une rente au
sens classique du terme – il perd son aspect illégale – mais son
montant modeste exclut la possibilité de générer des
effets macroéconomiques importants, d’autant plus que ce même
gouvernement a interdit (juillet 2000) par la suite la culture de l’opium.
[5]
La Colombie produirait approximativement 88 tonnes d’opium, le Mexique
21 en 2000 (contre 6O et 43 en 1998 et 1999) selon le rapport annuel de
l’ODCCP (2001) contre 3276 tonnes en 2000 et 4565 tonnes en 2000 et 1999
pour l’Afghanistan. Il est juste de remarquer cependant que quasi l’intégralité
de l’opium en Colombie est transformée en héroïne et
exportée. Enfin les dernières saisies d’héroïne
en Colombie laissent supposer que la production d’héroïne a
été soit sous estimée, soit qu’elle ait augmenté
considérablement en 2001. Au 30 juin 2001 ont été
saisis 750 kilos d’héroïne, soit 25% de plus que pour toute
l’année 2000, et le triple des saisies du premier trimestre 2000.
(Cambio, 23.7.2001)
[6]
c’est à dire une fois soustraites la consommation locale – que ce
soit celle des feuilles de coca ou celle du produit élaboré,
et les saisies en Colombie.[7]D’autres
données du DEA présentent ces données d’une autre
manière : la production colombienne serait de 298 tonnes en 1999,
à laquelle il convient d’ajouter celle du Mexique de 135 tonnes
et les saisies aux Etats Unis. Cette présentation diffère
légèrement de la précédente, dans la mesure
où elle compte comme production mexicaine, la rémunération
en nature payée par les organisations criminelles colombiennes à
leurs consœurs mexicaines pour prix de leur participation au transport
vers les Etats Unis de ces produits illicites.
[8]
Ces données sont calculées à partir d’une analyse
de la prévalence et du degré de pureté de la cocaïne
[9]
la voie mexicaine connaît des évolutions importantes :durant
les années 80, le « cartel » de Medellin utilisait plutôt
les routes passant par les Caraïbes pour faire passer la cocaïne
aux Etats-Unis, au début des années quatre vingt dix, la
voie mexicaine devient privilégiée (70 à 80 % de la
cocaïne destinée aux Etats-Unis) et les organisations criminelles,
de plus en plus puissantes, réclament un paiement en nature pour
prix de leur collaboration et surclassent en partie les organisations colombiennes.
L’immigration mexicaine importante au Etats-Unis permet aux organisations
criminelles mexicaines d’étendre leurs activités aux Etats-Unis
et de ne plus se limiter au commerce de gros. Il semble qu’à partir
de la fin des années quatre vingt dix, la situation change de nouveau.
On estime que 50% environ de la cocaïne et 80 à 90 % de l’héroïne
destinées aux Etats-Unis utilisent les routes carabéennes
(Bagley, 2001,p.3)
[10]
Il est intéressant de remarquer que les rapports de l’Etat aux trafiquants
sont très différents de ceux observés au Mexique et
en Colombie. A u Mexique, on peut dire que dans une certaine mesure, le
mouvement a été de l’Etat vers les organisations criminelles,
l’Etat cherchant à s’approprier une partie de la rente, notamment
sous la présidence de Salinas de Gotari (1988-1994), candidat favori
des Etats unis pour diriger à l’époque le Gatt, exilé
aujourd’hui et dont le frère est emprisonné (Rivelois J,
1999). En Colombie, le mouvement paraît avoir été inverse
: les trafiquants cherchant des appuis dans l’Etat (soit directement par
la corruption, soit indirectement par l’accès à des responsabilités
politiques) afin de faciliter leurs activités).
[11]
Les prix de gros étaient de 39000 dollars en 1988-89 aux Etats-Unis
et de 126000 dollars en Europe. Les prix de détail se situaient
autour de 86000 dollars aux Etats-Unis et 150000 dollars en Europe (même
source).
[12]
Les deux opérations sont souvent confondues dans les faits : blanchir
de l’argent sale passe par le rapatriement, mais il est important de les
distinguer car leurs motivations sont distinctes : on pourrait très
bien blanchir sans rapatrier par exemple. Le blanchiment obéit à
un triptyque : degré de sophistication – organisation – milieu institutionnel.
[13]
Plus exactement : un parent et plus absent, pourcentage-seuil de sans emploi
par famille, une fraction au sein des ménages ayant migré
dans les cinq ans, un pourcentage-seuil de personnes au sein d’une communauté
qui perçoit des revenus de la drogue
[14]
il s’agit d’une étude très intéressante que nous ne
pouvons exposer ici. Elle consiste à établir les taux d’homicide
par tranche d’âge et à tester explicatives citées,
l’originalité est dans la prise en considération du taux
d’homicide à une tranche d’âge pour essayer de mesurer son
influence sur les tranches d’âge suivantes
[15]
certains considèrent que cette relation n’existe pas. Peralva A.
(2001), spécialiste de la violence au Brésil, écrit
par exemple : « quelque soit l’importance des inégalités
sociales...il n’est pas possible d’ignorer que les taux de délinquance
croissent là même où les inégalités décroissent
»( 2001,p.8). Nous pourrions ajouter que lorsque la croissance a
repris au brésil et que l’hyperinflation a disparu, la criminalité
s’est fortement accrue dans plusieurs grandes villes brésiliennes.
Le taux d’homicide est passé de 40% environ à la fin des
années 92 dans la région métropolitaine de Rio à
70 fin 1995, c’est à dire à un niveau proche de certaines
villes colombiennes, et à Sao Paulo il est passé de 43%à
52% entre ces mêmes dates (Viegas Andrade et de Barros Lisboa, 2000
; p.387). Cette période est pourtant caractérisée
par une amélioration du niveaux de vie, une chute importante de
l’indice de pauvreté et enfin une diminution légère
des inégalités, surtout à partir de 1994. Peralva
A. fait de plus remarquer qu’ au Brésil à des indices d’IDH
régionaux élevés correspondent des taux de criminalité
forts et inversement.
[16]
l’informel est formellement illégal pourtant les emplois informels
dominent ; la mobilité sociale est quasiment absente sauf pour quelques
apprentis criminels, lorsqu’ils ne décèdent pas rapidement,
des sportifs, des chanteurs et des politiques ; lorsque les inégalités
sont très importantes, la corruption est visible et souvent massive
etc
[17]
politique, culturel, répressif, économique et enfin la prise
en considération qu’une partie de la culture et de la transformation
se fait sous contrôle des guerrillas qui prennent au passage une
dîme relativement conséquente
Favor compartir esta información
y ayudarnos a divulgarla citando a Mama Coca
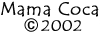
 Graphiques
2 et 3: Marché mondial de la cocaïne/des drogues
Graphiques
2 et 3: Marché mondial de la cocaïne/des drogues











