Les ravages d’une catastrophe humanitaire
La Colombie compte ses morts mais rien n’est
véritablement entrepris au niveau gouvernemental
pour enrayer la tragédie.
SEMANA (extraits)
Bogotá
En 2001, le conflit armé a coûté la vie à
3 685 civils, soit plus que tous
les innocents tués le 11 septembre.
Une catastrophe humanitaire, pire en un sens,
parce qu’elle ne fait pas que des morts.
Cette même année, 190 454 personnes
ont été déplacées et 160 syndicalistes
assassinés. D’une balle, 10 journalistes
ont été réduits au silence et on a recensé
3 041 enlèvements et 259 disparitions.
Seulement, ces tragédies ont lieu au goutte
à goutte, jour après jour, dans des villages
isolés. Et du fait même de sa fragmentation
[et de sa longévité, presque un demi-siècle],
on perçoit rarement ce drame dans toute son
ampleur : il ne suscite pas suffisamment
d’indignation.
Le gouvernement, ainsi que les citoyens encore
épargnés par la guerre, font comme
si de
rien n’était, comme si la situation
n’appelait
pas de mesures exceptionnelles. Jusqu’ici,
les solutions se sont toujours avérées
insuffisantes.
Il n’est pas si loin le jour où ce
drame
invisible, dont on croirait qu’il se
déroule
en Afghanistan, et non à Murindó ou
à Machuca,
se jouera soudain à chaque coin de
rue – non
plus avec deux ou trois déplacés brandissant
des banderoles, mais avec des dizaines
de
déracinés exigeant de la nourriture
par la
force.
Il est faux de dire, comme on l’entend trop
souvent, que ce pays est prêt à tout
supporter.
La situation ne cesse de se détériorer,
et
peut-être de manière irréversible.
Témoin,
le nombre grandissant de Colombiens
qui tombent
en dessous du seuil de pauvreté. Il
y a deux
décennies, 39 % de la population
gagnait
moins de 2 dollars par jour, on
en dénombrait
49 % en 1999, et aujourd’hui,
selon
la Banque mondiale, on serait passé
à 64 %.
Sur ces 27 millions de pauvres
[sur
un total de 40 millions de Colombiens],
pas moins de 9,6 millions d’indigents
n’ont pas de quoi couvrir leurs besoins
caloriques
minimaux. C’est comme si tous les habitants
de Bogotá et de Medellín vivaient avec
moins
de 1 dollar par jour.
La violation systématique des droits de l’homme
a beau favoriser la pauvreté, aucun
candidat
[à l’élection présidentielle du 26 mai
dernier] n’en a fait une priorité.
“Dans les premiers mois de l’année, le nombre
de personnes déplacées a doublé par
rapport
à 2001”, affirme Georges Comninos, chef de la délégation
du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) en Colombie. “La population civile n’est pas prise entre
deux feux, elle est véritablement l’objet
du conflit. Il suffit d’être sous l’influence
du camp adverse pour être considéré
comme
l’ennemi.”
Dans plusieurs catégories de problèmes humanitaires,
la Colombie bat tous les records :
le
taux le plus élevé d’enlèvements (hormis
les conflits africains), le plus grand
nombre
d’enfants enrôlés dans les mouvements
armés
et un nombre de civils tués équivalent
aux
morts des guerres de haute intensité.
[Depuis
le début du conflit, 4 millions
de Colombiens
ont pris le chemin de l’exil et 2 millions
de personnes ont été déplacées à l’intérieur
du pays]. Etre déplacé, ce n’est pas
seulement
perdre une maison et des objets personnels,
c’est surtout être déchiré intérieurement.
Des mécaniciens, des chauffeurs de
taxi,
des boulangers, des dentistes, des
secrétaires,
des fonctionnaires, au total 351 Colombiens
par jour – selon les estimations
prudentes
du Réseau de solidarité sociale, près
du
double selon l’ONG Codhes – doivent
tout quitter pour sauver leur peau.
Chacun
de ces hommes et de ces femmes était
quelqu’un,
son nom avait une histoire, sa famille
une
tradition. D’un jour à l’autre, ils
deviennent
des mendiants, déambulant dans les
rues d’une
ville, une pancarte à la main. Ils
ne sont
guère nombreux à essayer de revenir
dans
leur région d’origine. L’année dernière,
seule une personne déplacée sur dix
est rentrée.
Outre les syndicalistes et les journalistes
assassinés, en 2001, quatre curés et
treize
militants des droits de l’homme ont
été réduits
au silence pour toujours. Des dizaines
d’intellectuels
sont en exil. Tel est l’autre visage
de la
crise humanitaire que connaît le pays :
toute contestation est muselée.
Malgré tout, des dizaines d’organisations
donnent à manger à des enfants, s’occupent
des personnes déplacées ou rééduquent
des
mutilés de guerre. Le gouvernement
a amélioré
considérablement les soins d’urgence
aux
sans-abri. Et la communauté internationale
alloue de plus en plus de moyens à
des programmes
d’aide. Mais vu l’avalanche de calamités
qui s’est abattue sur la Colombie ces
dernières
années, de telles mesures restent désespérément
insuffisantes. La force publique n’axe
pas
son action sur la protection des civils,
les groupes armés déplacent les gens
impunément
et peu de maires s’engagent sur le
front
humanitaire. A l’heure qu’il est, il
n’existe
toujours pas de véritable système d’alerte
pour prévenir les massacres, et rien
n’a
été fait pour l’attribution collective
des
terres – une mesure qui empêcherait
que ceux qui déplacent les populations
ne
s’approprient les terres abandonnées.
Il
faudrait aussi assouplir la réglementation
pour faciliter les embauches d’urgence.
Au-delà du manque de moyens, souligne le
Defensor del Pueblo [sorte de médiateur au niveau municipal], “la principale faiblesse de l’action de
l’Etat réside dans l’absence d’une
vision
d’ensemble des conséquences du conflit
sur
la population civile”. En d’autres termes, le pays compte ses
morts, mais il ne mo bilise pas toutes ses ressources pour mettre
fin à cette tragédie qu’est la guerre. bilise pas toutes ses ressources pour mettre
fin à cette tragédie qu’est la guerre.
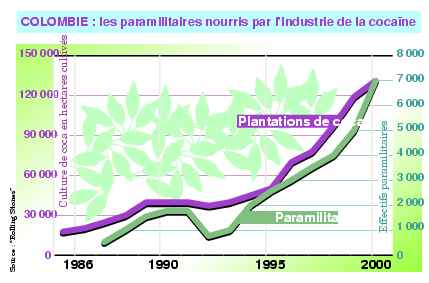
|
 Otage Otage
Ingrid Betancourt, la candidate écologiste
à l’élection présidentielle colombienne
(arrivée
en dixième position lors du scrutin)
est
toujours prisonnière des FARC. Figure
de
la lutte anticorruption, populaire
pour ses
campagnes chocs, véritable héroïne
à l’étranger,
son enlèvement, le 23 février
dernier,
a mobilisé l’opinion internationale.
Mais
l’intercession de parlementaires européens
est restée sans succès. Les FARC la
gardent
en monnaie d’échange contre la libération
de 300 des leurs.
|
Trafic
Les gros cartels ont disparu
Il y a moins de dix ans, quand on disait
trafic de drogue, on pensait cartels
et gros
barons et plusieurs noms – Fabio
Ochoa,
Carlos Lehder, etc. – venaient
à l’esprit.
Le plus célèbre narcotrafiquant colombien
Pablo Escobar – tué par l’armée
colombienne
en décembre 1993 – voulait
jouer
un rôle politique, manipulait le pouvoir
et les médias avec brio. Il avait déclaré
une véritable “guerre” à l’Etat, soldée
par
des centaines de mort. Son organisation,
le cartel de Medellín, a été officiellement
démantelée dans les années 90.
Les frères
Orejuela, chefs du cartel de Cali,
narcotrafiquants
en “cols blancs”, comme ils ont été
souvent
présentés, sont depuis 1995 en prison.
Depuis,
la police colombienne annonce régulièrement
l’arrestation d’un chef de cartel ou
d’un
autre (de la Côte, de Bogotá, de Pereira,
etc.) dont les noms sont souvent inconnus
du public. Et pour cause. L’époque
où les
barons de la drogue s’affichaient,
voire
pactisaient avec la politique est révolue.
Les affaires continuent mais elles
se font
plus discrètement. Les polices – et
pas seulement colombiennes – savent
que l’ennemi est devenu multiforme,
moins
visible mais tout aussi puissant qu’il
y
a dix ans. Confrontées à la répression,
les
grandes mafias colombiennes se sont
réorganisées
ou ont sous-traité. “Le trafic de drogue est aujourd’hui un problème
de culture et non de grands cartels”
reconnaît l’ancien conseiller à la sécurité
des citoyens du président Pastrana
dans l’hebdomadaire
colombien Cambio, “Les petites organisations cultivent, puis
fabriquent la cocaïne qui sera transmise
à d’autres organisations, mexicaines,
dominicaines
et autres…” Au Mexique, les mafias ont pris une telle
importance que le pays est en train
de devenir
“le nouveau narco-Etat de la région”, selon le quotidien El Mundo.
Les filières du trafic se sont atomisées
et mondialisées. Une des grandes fiertés
du cartel de Cali était autrefois d’avoir
su maîtriser le trafic de la production
à
la distribution. Ce ne pourrait plus
être
le cas aujourd’hui : bien d’autres
mafias
– russes, africaines par exemple –
jouent leur rôle d’intermédiaire. Les
routes
de la drogue n’ont jamais été aussi
nombreuses,
soulignent les Nations unies dans leur
dernier
rapport. Et les bénéfices qui en résultent
sont maintenant plus souvent investis
dans
les pays du Nord que dans les pays
de production.
Pablo Escobar voulait vivre, investir
et
mourir en Colombie. Aujourd’hui, les
lois
colombiennes sont telles qu’il est
devenu
plus difficile de blanchir de l’argent
sur
place. Mais cela n’empêche pas la production
d’augmenter. Car finalement la drogue
sert
surtout, sur place, à exacerber la
guerre
civile et la violence puisqu’elle alimente
en armes la guérilla de gauche comme
les
paramilitaires d’extrême droite.
|
|

